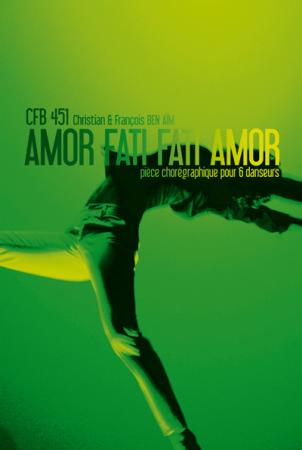Bien que sûr que non, on ne va pas la brûler, c'était juste pour faire un titre. N'empêche que depuis quelques jours des voix se font entendre, ouvertement agacées, et c'est nouveau. En premier lieu Rosita Boisseau qui y va de son solo dans Le Monde pour dénoncer les répétitions et les complaisance d'un système. Mais si essoufflement il y a, c'est avant tout celui du Théâtre de la Ville, sclérosé dans un système auto-référentiel, présentant essentiellement les mêmes chorégraphes années après années. Discours officiel: on est bien obligé d'inviter toujours les mêmes puisque forcement ce sont les meilleurs. Et cela tombe bien, puisque que le simple fait de passer au Théâtre de la Ville finit par valoir brevet d'excellence aux yeux du petit milieu parisien. D'autant plus pour des dates réservées un an à l'avance et devant des spectateurs prêts à s'entre-tuer pour récupérer un billet, pour voir ce qu'il y a de meilleur puisque c'est complet. C.Q.F.D.. Mais c'est la 26 eme année consécutive ou à peu prés que la grande dame de Wuppertal- ou la grande prêtresse de la danse occidentale ?-ou la star de Solingen ?- se présente dans ce lieu. C'est assez long pour que s'émoussent bien des passions. Pour une époque infidèle, la déesse est restée trés longtemps sur le piedestal. Lassitudes et agacements semblent se liberer d'un coup et sans complaisance, à la mesure de l'admiration quasi groupiesque qui jusqu'alors prévalait.
Si tout dans le jugement tient aux attentes, décues ou non, il y a en tout cas dans Bamboo Blues de quoi se laisser charmer, pour peu qu'on reçoive la pièce candide, désarmé. Voire, en ayant gardé une âme d'enfant. Ce carnet de voyage en Inde prend les couleurs chromo des anciens illustrés pour la jeunesse, ou d'une brochure de voyage un peu retro. Au commencement il y a le vent, fraiche invitation au voyage. Avant de faire place à des assaults de nonchalances et de féminités, auxquels on ne tarde pas à succomber. L'exotisme est bon enfant, dans les yeux et sourires de ce groupe de tigresses indolentes qui ne montrent pas les crocs. La déesse aux nombreux bras- est ce bien Khali? -semble pareillement inoffensive. Paix et amour: au premier rang on se voit invité à laisser filer entre ses doigts un ruban parfumé, à se laisser poser sur le front un point rouge. Danseurs et danseuses paradent en sari, un peu plus second degré mais tout autant policés que dans un défilé de mode. Les bandes musicales s'enchaînent comme entre deux escalators. Les duos, plus que les groupes, jouent ensuite les utopies de l'harmonie. Les rapprochements se concluent en jeux, en orgies de tissus colorés, glissades d'amour et démonstrations de sensualité, mais idéalisés pour une représentation tous publics. Ce qui se passe- ou devrait se passer- entre les hommes et les femmes à ce stade intéresse manifestement avant toutes choses la chorégraphe, on en oublie par longs moments le décor et le continent.
Pourtant, quelques notes de violoncelle plus tard, on plonge dans la passion bollywood: robe rouge, courses aveugles, polyphonie de querelles. De manière toujours trop distanciée pour permettre à quoi que ce soit de violent de nous surprendre. Histoire quand même de faire actuel, les tableaux se permettent des oeillades vers la modernité: courses en roller, angoisses de la mondialisation, danse du télétravailleur.... Il semble même suggéré qu'on ne dépeint pas ici un paradis terrestre, et ce jusque dans ce qui concerne les rapports entre les sexes. Mais après un passage par des ablutions intemporelles, on en revient aux exactes répétition de séquences de la première partie....éternel recommencement de l'éternel féminin dans l'orient éternel? Les danseurs courent sans se heurter, sinon du regard, sur leur chemin nul obstacle. Même quand il y a exubérance et vivacité, les mouvements recherchent harmonies, évidences, et fluidités. Sans s'attarder dans des originalités trop ostensibles. Il plane plus de sérénité et de rêverie que de blues dans tout cela. Mais le tragique n'est pas une obligation. C'est même, trop souvent, une facilité. On aurait même tout autant aimé Bamboo Blues, et ses rêves de bonheur, si Pina Baush avait été une débutante.
C'était Bamboo Blues, de Pina Bausch, au Théâtre de la Ville, jusqu'à mercredi encore.

 conscience de l'absence de public, de son attente et de ses frémissements, et surtout partout la présence du chorégraphe, absolument sympathique mais absolument flippé, qui s'excuse d'avance de présenter tout sauf la pièce car elle ne sera bien vraiment réglée que le lendemain, nous demandant de ne pas trop juger mais nous laissant voir quand même, nous laissant confronté à l'injonction paradoxale parfaite. C'est d'autant plus perturbant pour une pièce qui s'efforce de réussir une juxtaposition de formes vers la synthèse. Ce soir, l'énergie semble encore trop retenue.
conscience de l'absence de public, de son attente et de ses frémissements, et surtout partout la présence du chorégraphe, absolument sympathique mais absolument flippé, qui s'excuse d'avance de présenter tout sauf la pièce car elle ne sera bien vraiment réglée que le lendemain, nous demandant de ne pas trop juger mais nous laissant voir quand même, nous laissant confronté à l'injonction paradoxale parfaite. C'est d'autant plus perturbant pour une pièce qui s'efforce de réussir une juxtaposition de formes vers la synthèse. Ce soir, l'énergie semble encore trop retenue. 

 Décidément, non. Sans appel. On ne trouve rien à voir, ni à ressentir, ni à comprendre. La semaine d'avant, on pouvait être éxcédé par la pièce de
Décidément, non. Sans appel. On ne trouve rien à voir, ni à ressentir, ni à comprendre. La semaine d'avant, on pouvait être éxcédé par la pièce de  nouveaux produits culturels les yeux dans les yeux des hommes de marketing eux scrutant à coups de sondages quotidiens l’âme d'un public sous influence des publicitaires, et dans les librairies deux fois plus de nouveaux titres chaque année qu'il y a trois décennies et toujours un peu moins de livres vendus (sauf le goncourt qu'on achète pour ne pas le lire). On dit, en riant jaune, que les seuls encore à vivre décemment de leur metier dans le monde de l'édition sont les transporteurs, qui chaque semaine livrent aux libraires de pleins camions de nouveautés et en remballent autant d'invendus: c.a.d les nouveautés livrées le mois d'avant et à peine sorties des cartons.
nouveaux produits culturels les yeux dans les yeux des hommes de marketing eux scrutant à coups de sondages quotidiens l’âme d'un public sous influence des publicitaires, et dans les librairies deux fois plus de nouveaux titres chaque année qu'il y a trois décennies et toujours un peu moins de livres vendus (sauf le goncourt qu'on achète pour ne pas le lire). On dit, en riant jaune, que les seuls encore à vivre décemment de leur metier dans le monde de l'édition sont les transporteurs, qui chaque semaine livrent aux libraires de pleins camions de nouveautés et en remballent autant d'invendus: c.a.d les nouveautés livrées le mois d'avant et à peine sorties des cartons.