Les vetements tombent, Nightshade continue: quatre spectacles, quatre corps encore. Et oui, bien vu JD: la proposition de Claudia Triozzi, reproduit en plus court, et en modèle réduit, les procédés d'Up to Date. A moins que cette saynète, que vit déjà le Tadorne  à Marseille en janvier, ai été un brouillon de la plus longue pièce présentée en mai dernier aux RCIDSSD. Dans un cas ou dans l'autre, la chorégraphe semble utiliser le strip tease de ce soir comme un prétexte. Pour, plutôt que de profiter de la contrainte pour se remettre en question, tordre l'objet de force dans le sens de ses propres recherches...
à Marseille en janvier, ai été un brouillon de la plus longue pièce présentée en mai dernier aux RCIDSSD. Dans un cas ou dans l'autre, la chorégraphe semble utiliser le strip tease de ce soir comme un prétexte. Pour, plutôt que de profiter de la contrainte pour se remettre en question, tordre l'objet de force dans le sens de ses propres recherches...
Sans y arriver: Cécilia Bengolea ne trouve pas sa place dans le trop plein visuel qu'autour d'elle accumule Claudia Triozzi. Lors d' Up to date l'oeil perdait la danseuse, escamotée, plusieurs minutes presque invisible, dans un labyrinthe de formes et de couleurs. En dix minutes ici, impossible d'installer de tels effets. D'accoutumer le spectateur à l'ambiguité, puis de dérouler une narration. La contradiction ne se résout pas, entre l'obscurcissement qui est ici entrepris, et le dévoilement plus net qu'exigerait le genre. Le contraste n'apparait pas, le corps au départ habillé n'est jamais bien défini en tant qu'enjeu, ses avatars ensuite nous laissent à distance, étrangers. Perdu dans tout ce foisonnement, l'apparition finale et lumineuse d'un cul rond et nu, est juste incongrue.
Pourtant la Halle de la Villette se dégèle peu à peu, et restent toujours trois numéros à dévoiler. Avant Cécilia Bengolea, s'était effeuillée Delphine Clairet. Mais qui a surtout beaucoup parlé, avec les mots de Vera Mantero. Un commentaire bavard sur le strip tease, recherchant la connivence avec le spectateur, et c'est bien là où se situe le problème. Pour concilier dans le même espace-temps art et commentaire, il faudrait être aussi doué que Thierry Baé, le résultat est ce soir inévitablement aussi creux que la chose présentée par V.M. au Centre Pompidou l'automne dernier. Qu'elles soient entendues au premier, second ou trente-troisième degré, des inepties, enfilées comme des perles, restent des inepties. Pour ne prendre qu'un exemple, la supposée pudibonderie dont auraient été victimes nos ancêtres tient surtout du mythe qui a pour avantage de nous faire croire libérés nous mêmes. Il n'y a qu'à se souvenir de Zelda Fitzgerald plongeant à poil dans la fontaine de Washington Square durant les années 20 pour s'en persuader.
Un commentaire bavard sur le strip tease, recherchant la connivence avec le spectateur, et c'est bien là où se situe le problème. Pour concilier dans le même espace-temps art et commentaire, il faudrait être aussi doué que Thierry Baé, le résultat est ce soir inévitablement aussi creux que la chose présentée par V.M. au Centre Pompidou l'automne dernier. Qu'elles soient entendues au premier, second ou trente-troisième degré, des inepties, enfilées comme des perles, restent des inepties. Pour ne prendre qu'un exemple, la supposée pudibonderie dont auraient été victimes nos ancêtres tient surtout du mythe qui a pour avantage de nous faire croire libérés nous mêmes. Il n'y a qu'à se souvenir de Zelda Fitzgerald plongeant à poil dans la fontaine de Washington Square durant les années 20 pour s'en persuader.
Mais l'escroquerie consiste surtout à laisser exister, par une mise en scène bouffonne, une distance comique par rapport à ce qui est dit. Le spectateur, confronté à cette absence d'engagement, ne sait si ce discours aux implications artistiques et sociales est soutenu ou dénoncé. La seule victime de ce procédé un peu lâche est l'interprète Delphine Clairet, renvoyée à l'archétype de la grosse rigolote, à la tête creuse et aux avantages généreux. Dommage, car tout le beau potentiel de la strip teaseuse burlesque n'est pas exploité. Quand même, sauvée du gâchis, une belle et triste minute de poésie, quand pour sacrifier ses derniers vêtements à la nudité, c'est sur sa peau même que l'interprète doit les laver.
Moralité: arrivé à ce stade, on a rien vu, malgré le nu. On a rien vu de nouveau en tout cas. Ou rien trouvé à comprendre. Peut être, pour arriver à nous surprendre un peu, aurait il fallu plutôt demander aux chorégraphes de se déshabiller, et aux strip teaseuses de leur expliquer comment procéder...
Mais déjà montent sur scène Caroline Lemaire- avec Alain Platel- et Sky van der Hoek-avec Caterina Sagna, qui promettent, quoiqu'il en coûte, de nous montrer enfin toute la vérité... demain.
C'était Cécilia Bengolea ♥♥♥ chorégraphiée par Claudia Triozzi. et Delphine Clairet ♥♥ sur un texte et une chorégraphie de Vera Mantero, dans le cadre de Nightshade, à la grande Halle de la Villette, jusqu'au 13 octobre.
Guy
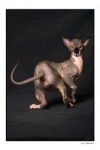 on aborde l'expérience elle-même un peu collet monté, bras croisés, comme resté au vestiaire, sans avoir pu se dépouiller de toutes les idées déjà faites. Et puis on se gèle à la Villette.
on aborde l'expérience elle-même un peu collet monté, bras croisés, comme resté au vestiaire, sans avoir pu se dépouiller de toutes les idées déjà faites. Et puis on se gèle à la Villette. Mais du tout furieux de ce soir, la part plus audacieuse, et la meilleure, tient plus aux mots- les mots écrits par
Mais du tout furieux de ce soir, la part plus audacieuse, et la meilleure, tient plus aux mots- les mots écrits par 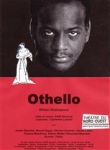 C'est sans doute la question la plus importante posée par la pièce. La seule question, même. A chaque mise en scène sa propre réponse. Ce soir la réponse est claire: on ne voit que Iago, qui tire toutes les ficelles, et Othello mené par le bout du nez. Ce qui reporte l'attention sur les motivations de Iago. Envieux ordinaire, ou être démoniaque? On se focalise sur ce personnage, mais peut être par l'effet d'un déséquilibre palpable du jeu: Iago (Alexandre Mousset, qui était tout autant remarquable dans le costume du fou de
C'est sans doute la question la plus importante posée par la pièce. La seule question, même. A chaque mise en scène sa propre réponse. Ce soir la réponse est claire: on ne voit que Iago, qui tire toutes les ficelles, et Othello mené par le bout du nez. Ce qui reporte l'attention sur les motivations de Iago. Envieux ordinaire, ou être démoniaque? On se focalise sur ce personnage, mais peut être par l'effet d'un déséquilibre palpable du jeu: Iago (Alexandre Mousset, qui était tout autant remarquable dans le costume du fou de 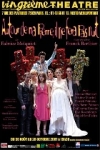 spontanées, et si systématiquement que cela à la longue peut agacer. Mais, si l'on est mieux disposé, la naïveté peut passer pour de la poésie. Et c'est, tous comptes faits, un mode d'expression approprié pour ces personnages tous un peu désoeuvrés, en quête de rêves et d'ailleurs, qui ont perdus le sens. Déboussolés par les "trous dans le ciel", la chaleur des nuits de polars et l'effacement des saisons. Des "essayeurs de vie". Qui forment une drôle de famille: un père travesti et en crise de larmes permanente, des frères détrousseurs de cadavres (pour marquer la dramatisation, faut il ouvrir sur du sordide?), leurs improbables amoureuses, et un poète alsacien en route vers la Californie. Une famille dont les liens échouent à consoler le mal-être de chacun.
spontanées, et si systématiquement que cela à la longue peut agacer. Mais, si l'on est mieux disposé, la naïveté peut passer pour de la poésie. Et c'est, tous comptes faits, un mode d'expression approprié pour ces personnages tous un peu désoeuvrés, en quête de rêves et d'ailleurs, qui ont perdus le sens. Déboussolés par les "trous dans le ciel", la chaleur des nuits de polars et l'effacement des saisons. Des "essayeurs de vie". Qui forment une drôle de famille: un père travesti et en crise de larmes permanente, des frères détrousseurs de cadavres (pour marquer la dramatisation, faut il ouvrir sur du sordide?), leurs improbables amoureuses, et un poète alsacien en route vers la Californie. Une famille dont les liens échouent à consoler le mal-être de chacun.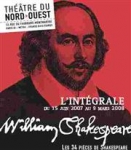 chemin dans l'ombre de Tarquin vers son crime, déjà sur la couche de Lucrèce l'opposition violente du rouge et du bleu. Puis la brutalité précipitée des gestes. Après, de quelques mouvements, le dégoût muet et prévisible qui envahi Tarquin. Le désespoir, la mort de Lucrèce.
chemin dans l'ombre de Tarquin vers son crime, déjà sur la couche de Lucrèce l'opposition violente du rouge et du bleu. Puis la brutalité précipitée des gestes. Après, de quelques mouvements, le dégoût muet et prévisible qui envahi Tarquin. Le désespoir, la mort de Lucrèce.