J'avais vu une première fois cette mise en scène du maitre de Santiago ici même en 2006.
Cette fois ci, mon ami Gilles en rend compte:
On ne sera jamais assez reconnaissant à Jean-Luc Jeener de donner, avec un budget quasi nul, trois fois plus de chefs-d’œuvre classiques (au sens large) en une saison que la Comédie-Française. Bien que ne tournant pas le dos aux auteurs officiels (Molière, Shakespeare, Racine, Genet, Beckett…) chers à la nomenklatura culturelle, il exhume aussi des œuvres de dramaturges moins en cour, voire quasiment enterrés, comme Corneille, Claudel, Giraudoux ou Montherlant. Ce faisant il œuvre pour la survie de la culture, la vraie, celle qui procède de la rencontre entre un auteur unique, avec ses passions, ses obsessions et ses idiosyncrasies, et un public d’hommes libres désireux de se construire et d’en savoir plus sur eux-mêmes et sur le monde.
L’œuvre de Montherlant repose sur une observation minutieuse de l’existence et sur le souci absolu de la vérité humaine. De cette observation (qu’on peut apprécier dans des œuvres quasiment naturalistes comme Les jeunes filles ou Les célibataires), il tire une morale et une métaphysique. Cette dernière repose sur la tension permanente entre un panthéisme nietzschéen, une animalité assumée (Pasiphaé, Le songe, Les bestiaires, etc), et une vision détachée et nihiliste de l’existence qui le rapproche des stoïciens, des mystiques espagnols et des jansénistes (Mors et Vita, Explicit Mysterium). Cette apparente contradiction n’en est pas une, puisqu’elle caractérise notre condition humaine ; mais, chez Montherlant, elle débouche sur une morale, qu’il qualifie de morale de l’alternance, et qui constitue une sorte de bréviaire permettant de concilier recherche du bonheur et acceptation lucide de notre condition de mortels. Il s’agit en somme d’agir selon ses passions, comme si on les prenait au sérieux, tout en se ménageant une porte de sortie, une stratégie d’esquive, parce qu’on sait bien que l’existence ne l’est pas.
Si le héros d’une œuvre de fiction autobiographique – Alban de Bricoule, Costals – se doit donc de pratiquer constamment cet exercice spirituel, au théâtre il est tentant pour l’auteur de se dédoubler, transformant ainsi la pratique de l’alternance en conflit entre des personnages pouvant susciter un intérêt dramatique. C’est sur ce principe que repose Le Maître de Santiago. Don Alvaro, austère « moine-soldat », aspire à la pureté et à la transcendance divine. Il vomit l’Espagne de son temps qu’il considère comme corrompue. Il ne désire plus que s’abîmer en Dieu. Les autres chevaliers de l’ordre disent oui à la vie. Ils rêvent de conquêtes, de pouvoir ; ils ne dédaignent pas la richesse ; ils veulent le bonheur de leurs enfants et acceptent les lois de l'existence. L’un d’entre eux, Don Bernal, par calcul, parce qu’il veut que son fils épouse la fille de Don Alvaro, et que celui-ci s’enrichisse afin de la doter, tente de convaincre Alvaro d’aller briguer argent et pouvoir dans le Nouveau Monde. Rien n’y fait, pas même l'objection évidente que cette exigence n'est qu'une forme d'orgueil. L'homme est déjà dans l'au-delà; les affaires terrestres ne lui sont plus qu'une nuisance.
De nos jours ce théâtre d'idées passe paradoxalement mieux à la scène qu'à la lecture; incarnés dans des personnages, les considérations éthiques et métaphysiques, les principes généraux n'en acquièrent que plus de force -- surtout s'ils s'opposent les uns aux autres. Les valeurs portées par l’œuvre de Montherlant sont si éloignées de l'esprit contemporain qu'elle gagnent en crédibilité, exprimées par des personnages en chair et en os. La mise en scène et les acteurs -- compétents voire excellents -- sont tout entiers au service du texte. Le décor se réduit à quelques braseros, qui enfument progressivement la pièce, tout en s'éteignant petit à petit, les uns après les autres. Évocation saisissante des conditions de vie au début du XVIe siècle, mais aussi symbole. La poésie des phrases sonne, les forces vitales et spirituelles se heurtent. La pièce se termine par un long épilogue élégiaque, marqué par le christianisme le plus sombre, celui de l'Ecclésiaste et de Pascal, après que le personnage principal eut convaincu sa fille, elle qui incarne l'amour de la vie, de se sacrifier pour le rejoindre dans son culte intransigeant du Néant.
Le maitre de Santiago d'Henry de Montherlant mis en scène par Patrice Le Cadre, vu au théâtre du Nord Ouest le 9 juin 2014.
Gilles
Postface au compte rendu de Gilles:
Ici est choisie l’épure, et ainsi tout est bien. Le texte file droit, sans trop d’effet ni de diversions, vers une conclusion inévitable : le refus de la vie. L’économie de décors et d’accessoires dit l’ascèse et la pauvreté. N’est laissé que ce qui prend du sens : l’épée, la croix… De rares lumières percent l’obscurité, jugements et décisions sont difficiles. Juste, la mise en scène autorise assez d’humanité à l’interprétation pour éviter que le propos ne devienne insupportablement sec, qu’il soit intense au contraire. C’est même une pièce où l’on se touche beaucoup, comme pour s’excuser de l’affrontement des idées, pour se consoler et s’assurer de rester encore soi-même un peu vivant.
L’essentiel est qu’il s’agit d’une belle pièce politique, car elle a la rare qualité de ne pas être manipulatoire, dans le sens où le spectateur peut faire son choix. Si l’auteur et le metteur en scène ne le font pas, Il est sain pour le spectateur de prendre parti, en regard des enjeux que la pièce peut agiter aujourd’hui. Ces enjeux ne sont plus ceux de L’Espagne du XVI° siècle, ni même ceux du contexte colonial contemporain de l’écriture de la pièce. Comme tout un chacun, je ressens comme il est tentant de céder aujourd’hui au dégout de la politique, de se détourner de la chose publique et de s’abstenir, pour affirmer sa propre intégrité. C’est sans doute la voie la plus facile. Mais aujourd'hui j’ai plutôt envie d’en finir avec Don Alvaro !
Guy


 texte d'une manière on ne peut plus efficace, intense et austère. Avec, comme les bons soirs au T.N.O, proximité entre le public et les comédiens, absence de décor, sobriété intemporelle de costumes tendance avant guerre. Pas si facile non plus de juger l'arbre à ses fruits: l'aveuglement d'Orgon, la victime, reste le principal ressort comique et dramatique de la pièce. Porté à l'extrème quant il faut que sa femme Elmire manque de se faire violer sous ses yeux par Tartuffe, afin qu'enfin ceux ci ne se dessillent. Comme quoi les femmes y voient clair bien avant les hommes, n'en déplaise à MMe Laure Adler qui expliquait il y a trois jours sur Arte que chez Molière les personnages féminins étaient ridicules ou insignifiants. Mais l'auteur ne dit rien ou presque des raisons de la folie d'Orgon, de la soif spirituelle dont il doit forcement souffrir au point de se livrer corps et âme à l'imposteur, lui offrir cet amour indécent et sa fille en prime. Sauf à admettre que richesses et plaisirs terrestres déaltèrent si peu qu'il faille les sacrifier aux faux prophêtes. Malgré les efforts de la justice, Tartuffe a de beaux jours devant lui.
texte d'une manière on ne peut plus efficace, intense et austère. Avec, comme les bons soirs au T.N.O, proximité entre le public et les comédiens, absence de décor, sobriété intemporelle de costumes tendance avant guerre. Pas si facile non plus de juger l'arbre à ses fruits: l'aveuglement d'Orgon, la victime, reste le principal ressort comique et dramatique de la pièce. Porté à l'extrème quant il faut que sa femme Elmire manque de se faire violer sous ses yeux par Tartuffe, afin qu'enfin ceux ci ne se dessillent. Comme quoi les femmes y voient clair bien avant les hommes, n'en déplaise à MMe Laure Adler qui expliquait il y a trois jours sur Arte que chez Molière les personnages féminins étaient ridicules ou insignifiants. Mais l'auteur ne dit rien ou presque des raisons de la folie d'Orgon, de la soif spirituelle dont il doit forcement souffrir au point de se livrer corps et âme à l'imposteur, lui offrir cet amour indécent et sa fille en prime. Sauf à admettre que richesses et plaisirs terrestres déaltèrent si peu qu'il faille les sacrifier aux faux prophêtes. Malgré les efforts de la justice, Tartuffe a de beaux jours devant lui. Dans le Médecin Volant, Sganarelle se dédouble. S'improvise médecin pour tirer d'embarras une ingénue. Puis piégé par sa propre imposture, doit s'inventer un frère jumeau moins honorable, jusqu'à rencontrer de plus en plus de difficultés pour jouer les deux personnages à la fois. Il prouve au moins en passant qu'il suffit d'être pédant pour apparaître comme un médecin compétent. Etre aux yeux des autres ce qu'il n'est pas vraiment. Les ingrédients des grandes tragi- comedies qui suivront sont déja présents... mais quand il écrit le Médecin Volant (1645),
Dans le Médecin Volant, Sganarelle se dédouble. S'improvise médecin pour tirer d'embarras une ingénue. Puis piégé par sa propre imposture, doit s'inventer un frère jumeau moins honorable, jusqu'à rencontrer de plus en plus de difficultés pour jouer les deux personnages à la fois. Il prouve au moins en passant qu'il suffit d'être pédant pour apparaître comme un médecin compétent. Etre aux yeux des autres ce qu'il n'est pas vraiment. Les ingrédients des grandes tragi- comedies qui suivront sont déja présents... mais quand il écrit le Médecin Volant (1645),  pour l'autre. L'un est noble et raffiné, l'autre veule et idiot, à 100 % gouverné par ses instincts. Comme deux faces irréconciables d'une même personnalité. L'intrigue est échevelée et irrésumable. La comédie de moeurs glisse insensiblement vers la noirceur, sans renoncer à un enjouement enfantin. Voire. On ne peut que s'effrayer que chacun des actes de l'un des jumeaux engage la vie-voire la mort-de l'autre. La comédie de l'argent et de l'amour ne connait pas de pitié, la société change pour un cynisme assumé, le siècle finira par s'effondrer. Interprété sur tréteaux en pleine ville par un dimanche ensoilellé, c'est une belle illustration de ce que peut offrir le théatre édudiant, avec vigueur et sincérité, mais avec justesse pourtant.
pour l'autre. L'un est noble et raffiné, l'autre veule et idiot, à 100 % gouverné par ses instincts. Comme deux faces irréconciables d'une même personnalité. L'intrigue est échevelée et irrésumable. La comédie de moeurs glisse insensiblement vers la noirceur, sans renoncer à un enjouement enfantin. Voire. On ne peut que s'effrayer que chacun des actes de l'un des jumeaux engage la vie-voire la mort-de l'autre. La comédie de l'argent et de l'amour ne connait pas de pitié, la société change pour un cynisme assumé, le siècle finira par s'effondrer. Interprété sur tréteaux en pleine ville par un dimanche ensoilellé, c'est une belle illustration de ce que peut offrir le théatre édudiant, avec vigueur et sincérité, mais avec justesse pourtant. Sur quel pied peut-on jouer, de quel oeil peut-on voir, aujourd'hui, le Marchand de Venise? On s'aventure sur un terrain moralement plus périlleux encore que celui où évolue
Sur quel pied peut-on jouer, de quel oeil peut-on voir, aujourd'hui, le Marchand de Venise? On s'aventure sur un terrain moralement plus périlleux encore que celui où évolue  C'est la première heure qui parait la plus longue. On écoute et on résiste. Comme contre tous les débuts de pièce? Malgré le Roi Philippe Desboeuf, magnétique, passé de l'autre coté de l'âge, osseux et aux longs cheveux d'argent, madré et reptilien. Mais tout au long de ces premières minutes, il n'y a rien à comprendre que l'on ne sache déjà: la grande scène du partage du royaume, les flagorneries de Gonerill et de Regane, la disgrâce de Cordelia, les premières manoeuvres d'Edmond, on connaît tout cela par coeur. Et le début de cette pièce chaque fois choque par trop d'invraisemblances. Qui peut croire à un Roi qui abdique avec tant de légèreté, et donne tout à ses filles? Il y a des difficultés insurmontables à rendre crédible la colère capricieuse de Lear contre la pudeur de Cordelia. Prétextes, fausse pistes... Pour nous mener où? Consolation: Philippe Desboeuf nous pétrifie de fascination, son interprétation du Roi Lear est dans notre esprit hantée du souvenir de celle du Roi
C'est la première heure qui parait la plus longue. On écoute et on résiste. Comme contre tous les débuts de pièce? Malgré le Roi Philippe Desboeuf, magnétique, passé de l'autre coté de l'âge, osseux et aux longs cheveux d'argent, madré et reptilien. Mais tout au long de ces premières minutes, il n'y a rien à comprendre que l'on ne sache déjà: la grande scène du partage du royaume, les flagorneries de Gonerill et de Regane, la disgrâce de Cordelia, les premières manoeuvres d'Edmond, on connaît tout cela par coeur. Et le début de cette pièce chaque fois choque par trop d'invraisemblances. Qui peut croire à un Roi qui abdique avec tant de légèreté, et donne tout à ses filles? Il y a des difficultés insurmontables à rendre crédible la colère capricieuse de Lear contre la pudeur de Cordelia. Prétextes, fausse pistes... Pour nous mener où? Consolation: Philippe Desboeuf nous pétrifie de fascination, son interprétation du Roi Lear est dans notre esprit hantée du souvenir de celle du Roi  cauchemard. Au
cauchemard. Au  gestes, une percussion, c'est assez pour quitter la rive et que surgissent de l'obscurité les images du Songe, de la Tempête, de Roméo et Juliette. Le choix de la sobriété. Pour emmener par les détours du conte les enfants, bouches bées, bien plus loin dans la complexité des pièces qu'on aurait pu le penser.
gestes, une percussion, c'est assez pour quitter la rive et que surgissent de l'obscurité les images du Songe, de la Tempête, de Roméo et Juliette. Le choix de la sobriété. Pour emmener par les détours du conte les enfants, bouches bées, bien plus loin dans la complexité des pièces qu'on aurait pu le penser. pendant quelques siècles. En tous cas une pièce atypique dans la production shakespearienne: ici nulle passion qui menerait un Macbeth ou un Othello jusqu'à son propre anéantissement, ni intrigue à proprement parler qui nous tiendrait en haleine. Trahisons, luttes de pouvoir: toute l'action a eu lieu avant la pièce, dans un temps ordinaire, suspendu par la tempête. Ensuite, comme dans les séries d'aujourd'hui, les naufragés rencontreront leur vérité à travers les épreuves. Mais c'est l'île elle même- et ses incarnations primitives: Ariel et Caliban- qui est le personnage principal de la pièce. Un lieu de magie, mais comme empreint d'une lassitude apaisée, où les passions se résolvent, où les fautes sont pardonnées.
pendant quelques siècles. En tous cas une pièce atypique dans la production shakespearienne: ici nulle passion qui menerait un Macbeth ou un Othello jusqu'à son propre anéantissement, ni intrigue à proprement parler qui nous tiendrait en haleine. Trahisons, luttes de pouvoir: toute l'action a eu lieu avant la pièce, dans un temps ordinaire, suspendu par la tempête. Ensuite, comme dans les séries d'aujourd'hui, les naufragés rencontreront leur vérité à travers les épreuves. Mais c'est l'île elle même- et ses incarnations primitives: Ariel et Caliban- qui est le personnage principal de la pièce. Un lieu de magie, mais comme empreint d'une lassitude apaisée, où les passions se résolvent, où les fautes sont pardonnées.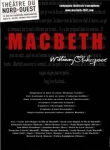 l'arbitre, c'est le grand Will en personne. Dans les ceux équipes, pas de stars internationale, mais des talents déjà remarqués. A noter, au nombre des transferts, Audrey Sourdive, déjà remarquée en pilier dans la mêlée des religieuses de
l'arbitre, c'est le grand Will en personne. Dans les ceux équipes, pas de stars internationale, mais des talents déjà remarqués. A noter, au nombre des transferts, Audrey Sourdive, déjà remarquée en pilier dans la mêlée des religieuses de  bien occupé, dominé d'un bout à l'autre. L'avantage est assuré par un jeu de haut niveau dés le début de partie, sur les thèmes de la prodigalité de Timon et de l'hypocrisie de ses invités. Jerome Keen marque l'essai. Actions d'équipes brillantes à la mi temps, alors que Timon est ruiné, la scène du banquet d'eau chaude servi aux convives avides est d'une précision et d'une énergie à couper le souffle. Dans un même mouvement, l'aisance et l'efficacité. La transformation est réussie, lors d'une belle malédiction jetée à la face d'Athènes, par un Timon amer. Le choc: on est plaqué. Fin de partie un peu moins vive, plus défensive, avec Timon l'ermite.
bien occupé, dominé d'un bout à l'autre. L'avantage est assuré par un jeu de haut niveau dés le début de partie, sur les thèmes de la prodigalité de Timon et de l'hypocrisie de ses invités. Jerome Keen marque l'essai. Actions d'équipes brillantes à la mi temps, alors que Timon est ruiné, la scène du banquet d'eau chaude servi aux convives avides est d'une précision et d'une énergie à couper le souffle. Dans un même mouvement, l'aisance et l'efficacité. La transformation est réussie, lors d'une belle malédiction jetée à la face d'Athènes, par un Timon amer. Le choc: on est plaqué. Fin de partie un peu moins vive, plus défensive, avec Timon l'ermite.