Sans Iago, Othello serait il quand même Othello? Sans les suggestions de Iago, se tourmenterait-il jusqu'au délire d'images de trahison? Deviendrait-il de lui même littéralement fou de jalousie, au point d'étrangler sa Desdémone? Suffit-il que Desdémone soit très femme et très sensuelle entre ses bras, pour que tôt ou tard il s'en effraye, jusqu'à la croire putain, forcement infidèle?
 C'est sans doute la question la plus importante posée par la pièce. La seule question, même. A chaque mise en scène sa propre réponse. Ce soir la réponse est claire: on ne voit que Iago, qui tire toutes les ficelles, et Othello mené par le bout du nez. Ce qui reporte l'attention sur les motivations de Iago. Envieux ordinaire, ou être démoniaque? On se focalise sur ce personnage, mais peut être par l'effet d'un déséquilibre palpable du jeu: Iago (Alexandre Mousset, qui était tout autant remarquable dans le costume du fou de la Nuit des Rois) est ici charmeur, nerveux et implacable, ouvrant un monde d'ambiguïté à chaque syllabe. Alors qu'il manque quelques années, ou quelques kilos, en tout cas encore de l'autorité à l'Othello de ce soir pour s'imposer solide et inquiétant, tel un tueur, tel un chef de guerre. Au moins est il crédible dans l'expression de la fragilité de la folie amoureuse: la scène du meutre ressemblera absolument à une scène d'amour. Partagée avec Karine Leleu (qui fût Pasiphae ici même), depuis le début charnelle, et innocente à la fois, jusqu'à la transparence. Ce duo s'est déjà épuré en une belle rencontre du noir et du blanc, à compter de l'instant où Othello, gagné par la folie et les ténèbres a abandonné son manteau. L'austérité de la scène du T.N.O., éclairée de quelques lumières est propice à d'aussi belles oppositions.
C'est sans doute la question la plus importante posée par la pièce. La seule question, même. A chaque mise en scène sa propre réponse. Ce soir la réponse est claire: on ne voit que Iago, qui tire toutes les ficelles, et Othello mené par le bout du nez. Ce qui reporte l'attention sur les motivations de Iago. Envieux ordinaire, ou être démoniaque? On se focalise sur ce personnage, mais peut être par l'effet d'un déséquilibre palpable du jeu: Iago (Alexandre Mousset, qui était tout autant remarquable dans le costume du fou de la Nuit des Rois) est ici charmeur, nerveux et implacable, ouvrant un monde d'ambiguïté à chaque syllabe. Alors qu'il manque quelques années, ou quelques kilos, en tout cas encore de l'autorité à l'Othello de ce soir pour s'imposer solide et inquiétant, tel un tueur, tel un chef de guerre. Au moins est il crédible dans l'expression de la fragilité de la folie amoureuse: la scène du meutre ressemblera absolument à une scène d'amour. Partagée avec Karine Leleu (qui fût Pasiphae ici même), depuis le début charnelle, et innocente à la fois, jusqu'à la transparence. Ce duo s'est déjà épuré en une belle rencontre du noir et du blanc, à compter de l'instant où Othello, gagné par la folie et les ténèbres a abandonné son manteau. L'austérité de la scène du T.N.O., éclairée de quelques lumières est propice à d'aussi belles oppositions.
C'était Othello de William Shakespeare, mis en scène par Edith Garraud, au Théâtre du Nord Ouest. Dans le cadre de l'intégrale Shakespeare, jusqu'à fin février.
 chemin dans l'ombre de Tarquin vers son crime, déjà sur la couche de Lucrèce l'opposition violente du rouge et du bleu. Puis la brutalité précipitée des gestes. Après, de quelques mouvements, le dégoût muet et prévisible qui envahi Tarquin. Le désespoir, la mort de Lucrèce.
chemin dans l'ombre de Tarquin vers son crime, déjà sur la couche de Lucrèce l'opposition violente du rouge et du bleu. Puis la brutalité précipitée des gestes. Après, de quelques mouvements, le dégoût muet et prévisible qui envahi Tarquin. Le désespoir, la mort de Lucrèce.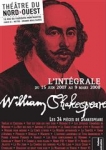 de Shakespeare est universelle. Si cette oeuvre est universelle, elle appartient donc à tout le monde. Si elle appartient à tout le monde, chacun peut bien en faire ce qu'il veut. Et détourner les flots du texte vers les préoccupations de l'époque. Chaque génération voit Willy à sa porte.
de Shakespeare est universelle. Si cette oeuvre est universelle, elle appartient donc à tout le monde. Si elle appartient à tout le monde, chacun peut bien en faire ce qu'il veut. Et détourner les flots du texte vers les préoccupations de l'époque. Chaque génération voit Willy à sa porte. Belle troupe qui chante à l'unisson, dont trois rousses qu'un ado dévore des yeux. Belle invitation, évocation un peu canaille, mais assez sage à tout prendre, des bas-fonds de Vienne.
Belle troupe qui chante à l'unisson, dont trois rousses qu'un ado dévore des yeux. Belle invitation, évocation un peu canaille, mais assez sage à tout prendre, des bas-fonds de Vienne. par la porte de la salle du haut surgissent des comédiens qu'on ne peut pas ne pas remarquer- des ours, un curé, un juge, des dames en robes d'époque, des jeunes premiers, un Falstaff qui se saisit de bois de cerfs...- ils tournent en rond seuls ou à plusieurs, mais toujours un peu absents, et bientôt repartent dedans à l'assaut. Et chaque fois que la porte de la salle du haut s'ouvre, on entend d'où l'on est quelques répliques et des éclats de voix, des applaudissements.
par la porte de la salle du haut surgissent des comédiens qu'on ne peut pas ne pas remarquer- des ours, un curé, un juge, des dames en robes d'époque, des jeunes premiers, un Falstaff qui se saisit de bois de cerfs...- ils tournent en rond seuls ou à plusieurs, mais toujours un peu absents, et bientôt repartent dedans à l'assaut. Et chaque fois que la porte de la salle du haut s'ouvre, on entend d'où l'on est quelques répliques et des éclats de voix, des applaudissements. pays de l'illusion, et de toutes les possibilités. On perd pied dans les sables mouvants de l'imaginaire amoureux, où chacun ose se rêver, sans interdit de rang ou de sexe, dans les bras de l'être aimé. Lui même reconstruit selon tous nos désirs.
pays de l'illusion, et de toutes les possibilités. On perd pied dans les sables mouvants de l'imaginaire amoureux, où chacun ose se rêver, sans interdit de rang ou de sexe, dans les bras de l'être aimé. Lui même reconstruit selon tous nos désirs.  flagrant, à l'inverse d'un certain Fabien aimant Sebastien-le frère jumeau- jusqu'à se faire battre pour le défendre.
flagrant, à l'inverse d'un certain Fabien aimant Sebastien-le frère jumeau- jusqu'à se faire battre pour le défendre. histoire d'amour à gros budget sur fond de guerre de Troie. En pratiquant des coupes radicales, ce qui explique sans doute pourquoi la sage Cressida couche dés le premier soir. Son troyen de Troïlus préfère faire l'amour que la guerre, on le comprend. On a droit à de belles scènes à deux et de hardies répliques. Comme c'est une tragédie, ça se complique: dans le cadre d'un obscur échange d'otages les habitants d'Illium envoient la belle se faire voir chez les grecs. La faute à la raison d'état!
histoire d'amour à gros budget sur fond de guerre de Troie. En pratiquant des coupes radicales, ce qui explique sans doute pourquoi la sage Cressida couche dés le premier soir. Son troyen de Troïlus préfère faire l'amour que la guerre, on le comprend. On a droit à de belles scènes à deux et de hardies répliques. Comme c'est une tragédie, ça se complique: dans le cadre d'un obscur échange d'otages les habitants d'Illium envoient la belle se faire voir chez les grecs. La faute à la raison d'état!

 au
au