-
-
Blanche Neige: la psychanalyse aprés les contes de fées
C'est lorsque que le conte de fée s'achève que commencent les ennuis, pour de vrai.
Dans son cercueil de verre rempli de pommes Blanche Neige recrache celle qu'elle avait coincée dans la gorge, revient à la vie dans la douceur d'un décor enneigé. Mais bientôt obligée de se formuler cette triste évidence: "Belle-Maman, tu m'as tuer (sic) !" Il faut vivre avec, continuer à vivre ensemble tous les quatre, en famille recomposée: la Méchante Reine, Blanche Neige, le Chasseur, le Prince étranger (Le roi compte pour du beurre, aveugle aux enjeux, réduit à quelques images inoffensives sur la toile de fond). Survivre avec l'innommable. Cette séance de psychothérapie familiale est loin d'être gagnée d'avance. Autant pour la résilience, malgré tout le talent de la reine pour la manipulation, et la bonne volonté de Blanche Neige pour nier les évidences et innoncenter sa belle mère de tous les forfaits...
(Mais écrire tout cela ne rend en rien compte de l'expérience de la pièce: ce drâme est drôlement mené, la mise en scene à l'image du beau texte de Walser: poétique et cynique, naive et cruelle, en appuyant sur le kitsh avec de douces outrances visuelles, rose et nudité. Tous déclament et cabotinent, en premier lieu Claude Degliame (La Reine) irrestistible, et Aurélia Arto (Blanche Neige) hébétée.)
...Donc rien n'est soldé, car les vrais conflits restent ouverts. On retrouve ici les principaux motifs qui seront plus tard developpé par Howard Barker (Le Cas Blanche Neige): l'angoissante rivalité sexuelle qui oppose blanche neige et la reine, quasi mère et fille, les difficultés qu'éprouve la jeune fille à exister et se débarrasser de sa virginité. Comme chez Barker, la Reine baise le Chasseur, et comme un aimant attire sur sa personne les élans du (pourtant peu viril) prince étranger... Mais que reste-t-il à Blanche Neige?
C'était Blanche Neige de Robert Walser, mise en scène Sylvie Reteuna, avec Aurélia Arto, Olav Benestvedt, Claude Degliame, Eram Sobhani, et la participation de Marc Mérigot, au théatre de la bastille, dans le cadre de trans, qui continue jusqu'à samedi avec Les Charmilles et Le Corps Furieux. Blanche Neige reviendra en juillet, à L'étoile du nord.
A lire: Neige à Tokyo, Allegro théatre et Fluctuat
A lire: Le Roi Lear par Sylvie Reteuna
A lire: aussi: Blanche Neige selon Howard Barker et Frederic Maragnani
... et pour ceux qui seraient vraiment trés curieux: Blanche Neige selon Ann Liv Young
photos (DR) avec l'aimable autorisation de la compagnie J.M. Rabeux
-
Sauvages
Céline Gayon, en grande carcasse joue l'ingrate qui se rêve une vamp', devant sa glace avantages en avants, s'assure l'être de gestes appuyés et trouve ses apparences, développe une drôlerie touchante. Mais c'est peut-être plus sérieux qu'il n'y parait. Pierre-Yves Aubin- Als das Kind Kind War – Interactions, s'éveille en culottes courtes, grandit trés vite. Il lui manque du temps pour nous faire comprendre son histoire, installer des reveries. Mais il réussit- c'est inattendu- à nous faire parler, presque ainsi évoquer des souvenirs que tous partageraient. Karima El Amrani et Joachim Maudet font jeux de mains, jeux de vilains; jeux de pieds, jeux de..., avec l'injuste fraîcheur de la jeunesse. C'est un pas de deux léger et mutin, relevé de vacheries et d'élégances, pour jouer chien et chat, frêre et soeur. Pas de répit: Nina Dipla court sans arrêts, obéit à une attraction invisible, sême tissus et rubans, les rattrape au prochain tour comme les enfants font au manège avec les chiffons, se recompose en mauve, rouge, orange. Elle instille par ces petites métamorphoses, curiosité, inquiétude, et malaise, inévitablement, l'espace se clôt soudain. Puis à bout de souffle sombre, dévoilée, semble régresser vers l'animalité: stupeur et tremblements, perte de soi? Sauvage également, Maki Watanabe, qui dit: un chat mort me nourrit. Flash-back, quelques semaines auparavant, dans un appartement: Maki Wanatabe improvise pour quelques dizaines de spectateurs. Plus un dernier, plus discret, installé dans l'antichambre, pupilles en amandes, qui semble de tous le moins surpris. Le chat est mon meilleur professeur, avoua-t-elle encore avant. Pour le moment elle grogne, miaule avec cette sauvagerie première et grotesque, qui semble toujours rendre le buto déplacé, inconvenant, juste toléré en marge de la danse contemporaine. Mais ici heureusement tout est permis, pour cinq brêves parenthèses dans l'actualité vaine.
C'étaient les spectacles sauvages, au Studio du Regard du Cygne.
-
Encore Eleonore
Vivre et laissez venir... La danse, en occurrence. Donc, lorsqu'elle veut, quelle importance?
On se soucie peu de l'heure. Maintenant ou hier, plus tard peut-être, Eléonore dedans, un instant à la fenêtre, mais tout dehors s'attarde le printemps, taquiné par un vent frais, savouré par une poignée de rescapés urbains. En école buissonnière dans le vert des allées de la Cartoucherie. Les nuages eux aussi attendent paresseux, et l'on entre, la danseuse allongée. Depuis longtemps? En solo, elle prend son temps. Plutôt d'une station à une autre que dans un mouvement. On la croirait à la recherche de la bonne position pour s'y figer. Toujours en recherche, tout simplement. S'y consacrant avec une telle concentration, que c'est sans doute cela qui détermine que nous sommes confrontés à une représentation. Le temps, qui se mesure par l'évênement, ne se mesure plus. Silence. Ni son, ni musique: on entendrait une mouche voler. Pas de rideaux aux fenêtres, la lumière peut s'inviter. Souvenirs: c'est la pièce qui a bougé, depuis la création. Des forces se sont équilibrées différement. De bandes de tissus l'espace s'est structuré au sol, en échos des barreaux verticaux. D'où viennent ces choses qui se sont mises en place depuis un an? Pour le moment: culotte noire, culotte blanche, nonchalance, pensées informulées. Dans la densité, des postures considérées. N'empêche: sous ce relâchement apparent, on perçoit des tensions bien moins innocentes, des arêtes, des apretés. Des sensations émergent, des idées vagues, pas trés loin d'être matérialisées. Mais qui ne semblent pas destinées à être explicitées, suspendues en chemin. On a des hypothèses, mais ne serait -il pas indiscret de les formuler? Dans ce silence, on s'entendrait penser. Et on se ferait entendre. Chacun pour soit garde son histoire, et maintenant on entend une mouche voler, vraiment. Quelques rumeurs du dehors, et une respiration, devant. S'il y avait un consensus, ce serait pour constater qu'il s'agit d'un duo avec l'escabeau. La plasticité de la chair, matière complaisante, confrontée à la rigidité géométrique du métal argenté. En commun, leur gravité. En alliance, sur le torse et le ventre de la danseuse: des bandes brillantes. Dans la lenteur ambiante, les brusques acélérations et décharges sont d'autant plus saissantes, et les inerties qui suivent d'une grande honneteté, soulignées de rares regards. La danse est là ausi informulée et floue que l'existence.
A un moment, c'est fini. On échange. Si nul ne parvient à en fin de compte vraiment raconter ce qu'il a vu, des spectateurs demandent à la chorégraphe de leur donner quelques clés . En vain. Eléonore Didier entend laisser à chacun sa liberté de recevoir et d'interpréter, mais livre quelques unes de ses inspirations. Elle confirme que l'échelle a quelque chose de viril, confie aussi la présence de fantasmes sexuels derrière cette danse. Sur ce terrain, personne ne lui demande d'explications plus détaillées. Il ressort de la discussion que LaiSSeRVenIR serait achevé... mais encore suceptible de bouger, de lui-même, de dedans. Ce processus de création parait aussi long qu'une psychanalyse. Avec beaucoup de patience, de determination, il faut du temps pour exister comme l'on veut.
C'était laiSSeRVenIR, présenté aux Ateliers de Paris- Carolyn Carlson.
A lire avant: Paris Possible, Solides Lisboa, laiSSeRVenIR à Mains d'Oeuvres....
photos de Gael Cornier avec l'aimable autorisation d'Eléonore Didier
-
Enfer et Damnation
Trop c'est trop!
C'est irréprochable pourtant à tous les niveaux, mais qui se superposent jusqu'à complête saturation. Mon premier est le sujet, tout sauf leger: l'Homme et Dieu, la mort, la damnation. Mon second est le texte de Goethe, dense et métaphysique, roboratif, intimidant, jamais apprivoisé. Mon troisième est un phrasé lituanien, tout en éclats et grondements. Mon quatrième est un sur titrage à attraper des torticolli. Mon cinquième est une gestuelle en rebus, surprenante et symbolique, déphasée du texte, quasi chorégraphique. Mon sixième est un décor eisenteinien, noir et ocre, funêbre et géométrique, Mon septième est une musique ommiprésente, lancinante et mélodramatique, qui ne ménage pas un instant de repos. Mon huitième accessoire tombe à grand fracas du plafond, pas dans la discrétion. Mon neuvième est le temps suspendu, 4 heures d'un entracte à l'autre, sur scène représenté obsessionnellement: un verre qui se vide et la vie qui s'enfuit.
Mon tout est un monstre de somptuosité et d'ennui. Pris au piège du risque de l'esthétique?
C'était Faust d’après JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, mise en scène EIMUNTAS NEKROSIUS, à L'Odéon.
photo par Ormitrii Matvejev avec l'aimable autorisation du théatre de l'Odéon
-
Olimpia, Stupre et fureur à l'Hotel de Ville
Sous les dorures assoupies, dans une semi-obscurité empoussièrée, une voix gronde pour réveiller l'histoire en éructant. Cette histoire là a une odeur entétante de foutre et de sang, de pourriture et de politique. Le texte, par ce corps jeté en avant, projette les images, devient ville, devient monde grouillant. La voix rauque fait fusionner d'un "je" dans son souffle furieux trois identités: celle de l'auteur- Céline Minard-, de la comédienne- Nathalie Richard-, et du personnage- Olimpia Maidalchini ; la "papesse", âme dammée d'Innocent X. Alors que la dépouille de ce pape pourrit, Olimpia, ivre d'or et pouvoir, vomit ses torrents d'imprécations, jette sur Rome qui la rejette ses furieux blasphèmes et malédictions. En un flux outré, cru et continu, aux couleurs pourpres des robes de cardinaux, des tissus déchirés, des chairs et âmes corrompus, du vin répandu. Avant d'être balayée par le temps et damnée par l'histoire pour avoir été femme, et femme de pouvoir.
Nous restons interdits devant ces mystères du vatican, sous les fresques et boiseries d'un de ces décors où aujourd'hui le pouvoir met en scène son apparat et police ses apparences....
C'était Olimpia de Céline Minard, lu par Nathalie Richard, dans la salle du Conseil de Paris, dans le cadre de Paris en toutes lettres.
-
Feydeau, panique
Trop crevante la Môme Crevette, et toujours increvable le Feydeau, encore aujourd'hui à la rescousse des billetteries. Bien plus fort que la recession, valeur refuge dans l'économie de la scène. Pour paradoxalement y représenter paroxysmes, crises, et déreglements. Comme par catharsis? Ici le trou noir né d'une soirée trop arrosée dans la vie paisible du bourgeois Petypon, susceptible par inflation d'emporter l'univers entier.
Dans le lit de Petypon le lendemain matin de migraine la môme crevette- danseuse au moulin rouge- matérialisation de désirs refoulés ou témoignage invavouable d'une autre vie qui aurait du rester cachée. Le bordel fait irruption au foyer...rien ne va plus. Sous les quiproquos c'est la réalité qui pans aprés pans s'altère. Les voiles qui font le décor se retournent pour ne plus rien cacher, les portes suspendues à de fragiles conventions s'envolent et les limites n'en finissent plus de s'effacer. Rien ne tient en place. Difficille de contenir chacun dans son espace réservé: la domestique à l'office, La môme dans le lit, les visiteurs au salon, le vieil oncle en Afrique... Petypon aux abois tente de gagner quelques minutes en pétrifiant les protagonistes sur un fauteuil extatique reduit à sa plus simple expression. Peine perdue: on ne ralenti pas l'entropie. Le langage n'arrange rien, embrouille: "les parôles ne signifient rien, c'est l'intonation qui fait le sens". La Môme Crévette-d'un naturel inaltérable- fait irruption dans ce monde bien reglé comme un élement perturbant que chacun choisit de voir comme il l'entend: ange venu du ciel, bonne nièce, femme honnête, élégante parisienne ou putain... Son langage leste et ses gestes osés donnent le la aux rombières de province, qui avalent tout et de concert remuent de la croupe et des seins par mimétisme parisien. Ou écoutent religieusement cinquante manières imagées de dire comment on se fait plaisir. C'est alors le paroxysme, tout cul par dessus tête, durant cette fête de sous-prefecture soudain onirique, où notables, dames, militaires et curé dansent en arrière fond une bacchanalle libératrice. Sydavier pousse cet exercice de metaboulevard jusqu'à ses limites, drôle et distancié à la fois. Le désordre est parfait, les comédiens "épatants" investissent dans le désordre et jusque dans la salle le cadre si précieux et surchargé de l'Odéon. Entre deux spectateurs, comme par contagion, une breve altercation. Aprés l'orgie, le dernier acte prend des allures de gueule de bois. Pas de salut possible sinon par une résolution bien factice, jusqu'au bout Mr Petypon aussi secoué que l'intrigue, Mme Petypon aveugle et pathétique, réfugiée dans la religion. Pas de fin possible, ni de retablissement de l'ordre sauf dans l'épuisement.
C'était La Dame de chez Maxim de GEORGES FEYDEAU
mise en scène JEAN-FRANCOIS SIVADIER, collaboration artistique : Nicolas Bouchaud, Véronique Timsit, Nadia Vonderheyden
scénographie : Daniel Jeanneteau, Jean-François Sivadier, Christian Tirole, lumière : Philippe Berthomé assisté de Jean-Jacques Beaudouin, costumes : Virginie Gervaise, décor : Amélia Holland, maquillage, perruques : Arnaud Ventura, son : Cédric Alaïs, Jean-Louis Imbert, chant : Pierre-Michel Sivadier, travail sensible : Vincent Rouche et Anne , assistante à la mise en scène : Véronique Timsit, régisseur général : Dominique Brillault, avec Nicolas Bouchaud, Cécile Bouillot, Stephen Butel, Raoul Fernandez, Corinne Fischer, Norah Krief, Nicolas Lê Quang, Catherine Morlot, Gilles Privat, Anne de Queiroz, Nadia Vonderheyden, Rachid Zanouda et Jean-Jacques Beaudouin, Christian Tirole.A l'Odéon, jusqu'au 25 juin.
Photo par Brigitte Enguérand avec l'aimable autorisation du théatre de l'Odéon
Prochain Feydeau: Le Didon à L'étoile du nord!
-
Faggianelli au delà des fleurs
On accepte le risque de se laisser apaiser. L'invisible est ici le projet, et la présence un signe. Fragile, subtil. On entend le tissu qui respire, crisse, la robe noire qui se soulève. Le torse se courbe et se tend, mû d'en dedans. Porté.
Elle tremble, au bord d'une transe. Se devine aussi éphémère que les fleurs coupées. En un instant de crépuscule, l'immobilité. Une, deux... Ce duo ressemble un écho, on apperçoit des allers retours entre les avants et les aprés de ces deux personnages féminins. On ne voit pas, on devine. Les correspondances naissent. Des évocations justes esquissées, des souvenirs sereins, jamais mièvres. Diane bande son arc, une nymphe rève, se transforme en une danseuse espagnole. Des arrêts, des disparations laissent tout en suspend, chaque histoire s'évanouit avant d'être, comme le frôlement d'une invisible ligne, et l'abandon de tout regret. Les fleurs se répandent, les courses coulent et se troublent dans une mer de pétales. Plâne le parfum d'un deuil tranquille, une danse qui ne durerait qu'un été. Le calme prend de l'ampleur, de la densité, le temps s'entend. Leger, on se tait.
C'était Récits dispersés de Marie-Jo Faggianelli, avec Marie-Jo Faggianelli et Wen-hsuan Chen.
A Mains d'Oeuvres, ce soir et demain.
A lire: Images de danse
Photo 1 de Mohamed Khalfi avec l'aimable autorisation de Mains d'Oeuvres
Photo 2 Jérome Delatour- Images de danse
-
Benny Golson whispers
Ce murmure là de saxophone, d'une virilité contenue, d'une volubilité tranquille, c'était- il y a 20 ans- d'une terrible efficacité pour titiller de vibrations troublantes le sexe opposé, pied au plancher, fenêtres ouvertes et volume poussé haut sur le radio cassette. Cette musique là était assez originale pour faire intellectuelle, alors assez vieille de déja 30 ans de plus pour être parée de la qualité mystérieuse des choses historiques, assez entendue pourtant pour permettre à chacun de se raccrocher à quelque chose de vaguement familier (Car ce Blues March avait servi pendant une éternité de générique sur Europe 1 à l'émission de Fillipachi et Tenot). Quelques kilomètres ensuite, pour se faire pardonner les assauts à la hussarde des baguettes d'Art Blakey, on envoûtait sur l'autre face avec Whisper Not, un sourire esquissé, une caresse, un baiser.
Ce soir Benny Golson ressouffle Whisper not, en notes sinueuses et colorées. La mélodie se laisser couler tout en médium, sans jamais que le musicien ne force, avec tout au plus quelque grognements graves et jamais d'échappées aigues. Si l'on craint que le tenor ait avec l'âge perdu un peu de coffre, on peut réécouter les vieux enregistrements: la puissance, surtout la manière sont les mêmes qu'à la fin des années cinquante. Le style depuis épuré de quelques échauffements rythm' blues, qui avec le recul apparaissent comme des facilités de l'époque hard bop. Sax posé, Golson raconte le triste jour de 1957, partagé avec Dizzy Gillespie à l'Appollo, de la disparition d'un musicien à l'âge de 26 ans, et offre son hommage au trompettiste: "I remember Clifford". Les années ont vécues mais Benny Golson a le temps, seulement 80 ans, et plus du tout besoin d'épater. Au saxophone il continue à dialoguer avec les ombres, et les notes s'évadent du passé. L'invocation de fantômes aux noms illustres fait partie ce soir de la visite. Mais aucun de ces hommages n'est gratuit, chacun le pendant d'un thème musical hanté de souvenirs mélancoliques, colorés. Tel Stablemates une de ses première compositions, que, raconte-t-il, son ami Coltrane fit enregistrer par Miles Davis. Les ballades sont vives, jamais mievres, piquantes et subtiles. Les phrases de Golson flottent, véloces mais détachées, en un sens modestes. Le leader délégue tout le panache à la trompette, avec le soin de faire briller les notes haut comme il faut, l'explicite du tempo à la section rythmique franco-américaine, attentive et respectueuse: piano discret, contrebasse veloutée, cymbales ouatées.
S'émerveillent ce soir au Duc des Lombards quelques dizaines de rescapés, d'amoureux de l'inactualité, qui imaginent ou se souviennent delicieusement d'un temps libre et insouciant, quelques mois avant l'arrivée fracassante du free jazz, de Coleman, de Dolphy pour qu'ensuite tout change à jamais. D'un temps où cette musique ne se posait pas encore la question d'être ou non militante. D'un temps tout simplement où cette musique était écoutée. De moments inutiles et sublimes, pour un soir recréés. Durant lesquels on se sent tout à fait bien, surtout si on est deux.
C'était Benny GOLSON (ts), Pierre-Yves SORIN (b), Alain JEAN-MARIE (p), François BIENSAN (tp), John BETSCH (dms), au Duc des Lombards.
Photo de Benny Golson (D.R.) avec l'aimable autorisation du Duc des Lombards.
-
Maki Watanabe - 2

![sc00f5ff13_2[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/00/00/904883340.jpg)


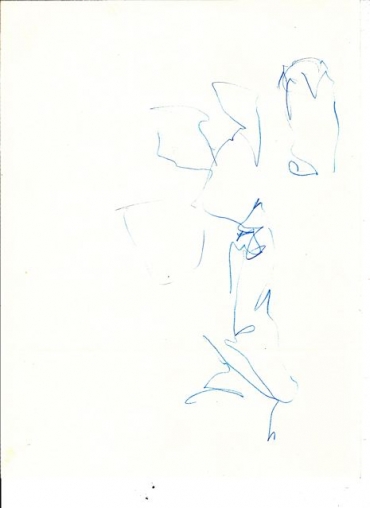
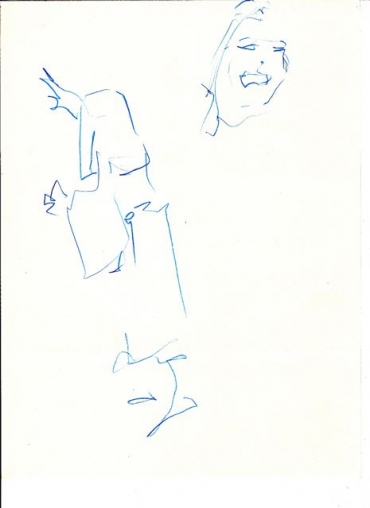
Improvisations de Maki Wanatabe, le 18 mai 2009, saisies sur le vif par Pierre Estable ( crayon de couleur sur papier, 29 cm / 21 cm )
Maki Watanabe danse le 12 juin au Regard du Cygne.

![3306844295_cb1dd461ec_o[1].jpg](http://unsoirouunautre.hautetfort.com/media/00/01/35780829.jpg)







