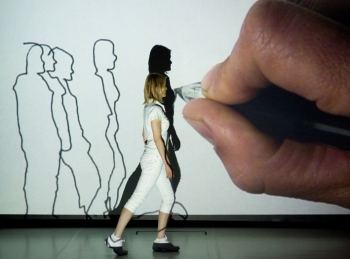Ce 6 avril 2018, Jacques Higelin est mort. Souvenirs de 1981 et 2010:
Tout commence sans Higelin, mais avec Duke Ellington (Jubilee Stomp, 1928), bousculé en trio de cuivres avec des couleurs free-jazz sixties. Le manifeste que l'on peut jouer avec les époques, iconoclaste mélanger l'avant et maintenant. Vu d'ici, du fond du balcon de la Cigale bourrée de jeunes et vieux le 10 janvier 2010 (en vérité vu d'assez loin de la scène), Higelin a juste un peu blanchi-et moi surement pas du tout- depuis le concert à Mogador du 4 janvier 81. Vu d'ici le bonhomme ignore ses 69 piges hirsutes, il s'en fout, il bouge comme avec 50 de moins... 1981, c'est vu d'ici de loin aussi, dans des souvenirs flous. Mais sans hésiter, c'était pas mieux avant que maintenant. Déja en 1981 sans équivalent, je m'écris alors maladroit que c'est "superbe et inracontable, champagne et roses pour tout le monde, que je n'ai jamais vu un mec parler comme ça à son public"... A la réflexion rien vu de tel depuis non plus. Car toujours encore étonné, il chante ce soir en éternel jeune amoureux, voix à râper, avoue toujours ne savoir sur quel pied danser. Les vieilles chansons des seventies ont juste ce soir un peu moins qu'alors d'avance sur leur temps. Paris New-York, New York-Paris : c'est panne de lumière à Santiago, et crise mondiale, en crescendo la musique qui s'emporte, dure jusqu'à l'asphyxie. Ici et maintenant, il en faut plus que jamais, pour tenir, rire et respirer, de l'énergie. Ses chansons d'aujourd'hui et d'avant c'est tout comme. Trempées de soul et de sueur, de bastringue et genérosité, remuées, les mots pétillants, genres musicaux sans dessus dessous, pour culminer avec Pars en reggae. La petite nouvelle Palema Norton aussi noire comme l'ébène que sa cousine Mona Lisa Klaxon (avec ce soir dans sa jungle un vrai trombone). En 81 à Mogador il y avait un orchestre incroyable et démesuré: deux batteries, pleins de cuivres, de guitares, de claviers, et même un violoncelle électrique, limite épat'. Ce soir de 2010 on est heureux autant, c'est plus resséré et toujours rock 'n roll, un groupe assez carré égayé par le trio de souffleurs, concentré à l'essentiel. Ainsi Champagne qu'Higelin chante et fait déborder au piano accompagné du seul percussionniste (et d'une foule de créatures fantomatiques invoquées en route). Moins de monologues- la trop grande phraaaase tue la phrase- mais des intros toujours foutraques, surtout l'insouciance de naturellement tout pouvoir dire sans s'en soucier et tout se permettre, et même chanter en public être amoureux d'une cigarette. Toujours enfant on peut tout se permettre. Retombé en enfance, tête en l'air comme jamais. Et sage, et lucide, pourtant: parôles et musique de cette nouvelle Valse FM grattent drôlement, sardoniques et crépusculaires, avec des frottements harmoniques à la Kurt Weil. Aussi cruel que Crocodai, l'occasion d'un pied de nez aux crocodiles birmans et un hommage bienvenu à Aung San Suu Kyi . A son invitation, on chante ensemble aussi faux qu'en 81 et on s'en fout (alors Hold tight, ce soir la chorale de Gourdon d'Aout put), mais heureux plus de deux heures durant (trois heures et demie en 81, j'avais noté, mais en s'en fout tout autant). Ce qui est important, c'est que ces grands artistes on les aime -en plus de leur talent- à pouvoir sembler être ce qu'on ne parvient pas à être soi-même, aussi clairement, aussi parfaitement: ici juvénile, éternellement. Comme disait Baudelaire, le génie est l'enfance dotée d'organes adultes pour s'exprimer. La musique est la même qu'en 81, mais aujourd'hui on en a encore plus besoin. Il y a un rappel, peut-être d'autres après, et les souvenirs on s'en fout également. Il ne s'arrêtera jamais, et demain ce sera vachement mieux.
C'était Jacques Higelin à la Cigale, le 10 mars 2010, et partout en France après.
Guy
posté le 17 mars 2010