Les créations de cette compagnie me posent problème, tant elles me semblent jouer en creux avec les attentes et les réactions du public. Au détriment du fond, de l'affirmation? Ces propositions (provocations?) m'inspirent prolixité, scepticisme, ou emportements polémiques, c'est selon. L'accent étant tant mis sur la relation, risquée et tenue, que le contenu souvent s'évacue, me laisse avec la peur du vide. X-event 0 pousse jusqu'à un point extrême ce déséquilibre. Mais pour le coup ce n'est pas le cas ici, pour un projet on ne peut plus lisible. Le point d'arrivée est d'avance annoncé: la reproduction en corps d'un motif de tête de mort, une vivante vanité (dont on peut considérer les inspirations avec des lunettes rouges).

Pas de surprise possible: au mur une video témoigne de la prise d'une photo identique, la cible. Mais c'est la manière complexe et imprévisible dont les danseurs vont parvenir jusqu'à cette image-cible qui constitue la performance en tant que telle, et tout autant nos efforts de spectateurs pour trouver une lisibilité à leurs actions. Dans ce sens l'expérience est ouverte. Le terrain de représentation est constitué d'une salle entière d'exposition, le public en demi cercle, plus ou moins. D'autres spectateurs au balcon. Les sept danseurs tendent à s'échapper du centre, et déborder les espaces d'observations, nous incitant à nous déplacer à notre tour. Ils bougent de temps en temps de quelques mêtres, vers l'immobilité, de stations en stations. Ils s'allongent alors, dans de telles positions, qu'on pourrait croire qu'ils se relaxent ou s'échauffent plutôt qu'ils ne commencent la performance. Il faut avoir la photo du crane en tête pour comprendre que chacun des sept compose déja l'un des élements de cette construction, mais pour le moment séparés. Le public est silencieux, discret, ne se déplace pas vraiment. Il y règne ici plus de recueillement que dans une église pour un enterrement. Le lieu d'art contemporain est blanc comme la mort, dépouillé. Au mur, ou dans la salle, des œuvres raréfiées. Qui passent au second plan derrière les mouvements vivants. Les danseurs sont vétus d'abord, de sportwears colorés. Puis dans un ordre dispersé ôtent et remettent bas et hauts. Leurs déshabillages et rhabillages mesurés font basculer l'entreprise et ses enjeux du coté de l'économie de l'érotisme. D'autant que le nu est attendu, annoncé par la vidéo. Pour s'agencer en un symbole funêbre, c'est la promesse d'une riche opposition. Je ne sais si elle sera tenue. Et les corps en jeu sont jeunes et beaux, filles et garçons. Des corps non désirants pourtant, froids, non agissants, utilisés, ramenés à l'état de matériaux sans cesse ré-agencés dans la construction du tout. Leurs regards absents. Dans cet espace blanc, des signes. Mais que je peine à déchiffrer, de plein pied avec les danseurs. Un mur sépare partiellement la salle en deux, empêche à partir d'un même poste d'observation de tous à la fois les considérer. Est-ce une occasion perdue pour méditer? Mon attention se fixe de moins en moins sur leurs déplacements, se lasse de cette poursuite, je me hasarde à la mezzanine, à la recherche d'un point de vue d'ensemble, plus vertical. Cela me permet distinguer d'en haut les figures, qui tendent plus ou moins vers un agencement. D'ici c'est plus intéressant, organique en sens, ces formes se font et défont, entropiquement, et sans donner le sentiment d'une intention. Plutôt d'obéir à des lois physiques. Il y a à entendre une rythmique sous- jacente, qui berce ces allers-retours, ces répétitions. Mais je m'en lasse aussi, redescends. Pour alors constater qu'une forme est enfin constituée, l'état stable, rassemblé.

Sauf que l'image est d'ici intelligible, voire le déclencheur d'interprétations incongrues: une orgie pétrifiée? Des figures animales rassemblées pour se réchauffer? Un charnier? A l'horizontal il n'y a que des nudités et des détails immanimés. Avec retard, je devine le crane sous les chairs. Pour le saisir, je retourne au balcon. Trop tard, les danseurs se dispersent déja, comme repoussés les uns les autres par des forces magnétiques. Seuls.

L'image funêbre s'est décomposé. Il ne subsiste que le fantôme de la forme, dans le vide autour de la danseuse du milieu. Gisante. La dissolution ne se produit pas d'un coup, progressivement, les élements survivent un peu, les corps peu à peu rhabillés, de retour vers le quotidien, l'activité. Pour se disperser parmi les spectateurs. C'est un retournement inattendu du symbole. La sensation me faisant toujours un peu défaut, pas déprimé pour autant, ni convaincu de la vacuité de l'existence, je cherche le sens. La morale de cette vanité. Je ne sais si cet art est mort ou vivant.
C'était piece en sept morceaux, des gens d'Uterpan, au centre d'art contemporain de Bretigny
Guy






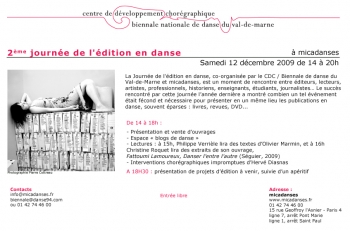


 soudaines éruptions de stridences et de provocations, avec un humour féroce et politique, avec des impressions de sang, de larmes et de sueur, et d'un bout à l'autre, malgré des plages de réveries et de tendresse, un grondement de révolte et de colère. Un morceau hurlé à six solistes qui se soutiennent et se répondent. Un morceau traversé d'éclats modernistes et toujours techniquement maitrisé.
soudaines éruptions de stridences et de provocations, avec un humour féroce et politique, avec des impressions de sang, de larmes et de sueur, et d'un bout à l'autre, malgré des plages de réveries et de tendresse, un grondement de révolte et de colère. Un morceau hurlé à six solistes qui se soutiennent et se répondent. Un morceau traversé d'éclats modernistes et toujours techniquement maitrisé.