texte mis initialement en ligne le 25/7/2010
Entrevues à travers un voile de chaleur: des hallucinations moites, des impressions charnelles offertes aux faibles lueurs d'un néon. Au point de basculement de l'insomnie, les rêves plongent profond. Vais-je accepter à froid cette invitation onirique?

Le fil semble ténu, abandonné aux associations d'images et d'idées. Mais pourquoi pas, doucement invité, placé comme dans un cocon? Les chuchotements hors champs planent obscurs, presque inintelligibles, mais esquissent les limites floues d'un voyage onirique en état d'hypnagogie. D'abord un théatre d'ombres blanches, d'étreintes évanouies et de frôlements voluptueux. Les créatures émergent devant moi, êtres hydriques, dévoilées et masquées, flottent avec lenteur comme les méduses entre deux eaux, jettent le trouble. La apparitions surprennent, peut-être vénéneuses. Je suis par moments tenté de m'éveiller mais finalement je poursuis avec ces créatures ce rêve en apnée. Les pensées dérivent et désirent. Les gestes des ces femmes se balancent comme les algues entre deux eaux. Le balancement lourd des langueurs fait se passer quelques longueurs.

Les images émergent peu à peu de l'indetérmination aquatique, désormais plus nettes. Je renonce à suivre une structure et accepte d'autres rencontres dans ce songe en labyrinthe, comme elles viennent, me plie à leur rythme: scénettes absurdes, jeux interdits qui basculent dans une drolerie plutôt cruelle, extraits imaginaires d'une comédie musicale mutine. Le metteur en scène ne craint pas d'abuser de demander à des jolies femmes de faire de jolies choses (pour paraphraser le cineaste François Truffaut), mais on ne se résoud pas à le lui reprocher. C'est une chaude nuit d'été et le voyage est plein de belles surprises, jusqu'à l'heure du réveil.
C'était l'Insomnie des Murènes, m.e.s par Laurent Bazin, à la Loge, repris jusqu'au 17 mars 2011.
Photos de sven Andersen avec l'aimable autorisation de la compagnie Mesden
Jerome Delatour y était aussi: lire ici.






 texte d'une manière on ne peut plus efficace, intense et austère. Avec, comme les bons soirs au T.N.O, proximité entre le public et les comédiens, absence de décor, sobriété intemporelle de costumes tendance avant guerre. Pas si facile non plus de juger l'arbre à ses fruits: l'aveuglement d'Orgon, la victime, reste le principal ressort comique et dramatique de la pièce. Porté à l'extrème quant il faut que sa femme Elmire manque de se faire violer sous ses yeux par Tartuffe, afin qu'enfin ceux ci ne se dessillent. Comme quoi les femmes y voient clair bien avant les hommes, n'en déplaise à MMe Laure Adler qui expliquait il y a trois jours sur Arte que chez Molière les personnages féminins étaient ridicules ou insignifiants. Mais l'auteur ne dit rien ou presque des raisons de la folie d'Orgon, de la soif spirituelle dont il doit forcement souffrir au point de se livrer corps et âme à l'imposteur, lui offrir cet amour indécent et sa fille en prime. Sauf à admettre que richesses et plaisirs terrestres déaltèrent si peu qu'il faille les sacrifier aux faux prophêtes. Malgré les efforts de la justice, Tartuffe a de beaux jours devant lui.
texte d'une manière on ne peut plus efficace, intense et austère. Avec, comme les bons soirs au T.N.O, proximité entre le public et les comédiens, absence de décor, sobriété intemporelle de costumes tendance avant guerre. Pas si facile non plus de juger l'arbre à ses fruits: l'aveuglement d'Orgon, la victime, reste le principal ressort comique et dramatique de la pièce. Porté à l'extrème quant il faut que sa femme Elmire manque de se faire violer sous ses yeux par Tartuffe, afin qu'enfin ceux ci ne se dessillent. Comme quoi les femmes y voient clair bien avant les hommes, n'en déplaise à MMe Laure Adler qui expliquait il y a trois jours sur Arte que chez Molière les personnages féminins étaient ridicules ou insignifiants. Mais l'auteur ne dit rien ou presque des raisons de la folie d'Orgon, de la soif spirituelle dont il doit forcement souffrir au point de se livrer corps et âme à l'imposteur, lui offrir cet amour indécent et sa fille en prime. Sauf à admettre que richesses et plaisirs terrestres déaltèrent si peu qu'il faille les sacrifier aux faux prophêtes. Malgré les efforts de la justice, Tartuffe a de beaux jours devant lui.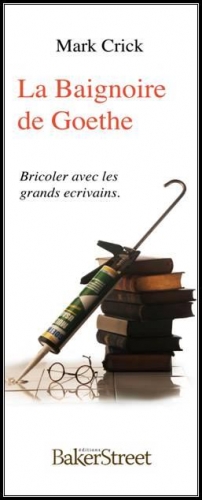
 différence. Au placard robes orange et maquillage blanc, oubliés les éclairages. Assis le long des murs de la Galerie Tampon, on est jamais pourtant dans une salle et presque dans la rue encore, où on voit les passants s'arrêter face à la vitre, regards happés dedans. Est-ce pour marquer la rupture avec toute esthétique de la lenteur ?- Toru attaque en un rythme physique et saccadé, par courses et bonds, exacerbé jusqu'à la chute. Il va court et vient au milieu de nous, on se colle contre le mur. Relié du regard, à distance de vibrations, il y a assis l'ami
différence. Au placard robes orange et maquillage blanc, oubliés les éclairages. Assis le long des murs de la Galerie Tampon, on est jamais pourtant dans une salle et presque dans la rue encore, où on voit les passants s'arrêter face à la vitre, regards happés dedans. Est-ce pour marquer la rupture avec toute esthétique de la lenteur ?- Toru attaque en un rythme physique et saccadé, par courses et bonds, exacerbé jusqu'à la chute. Il va court et vient au milieu de nous, on se colle contre le mur. Relié du regard, à distance de vibrations, il y a assis l'ami  escaliers, les spectateurs bien habillés dont des dames à visons, les rideaux très rouges et les dorures au plafond, le sentiment de s'y glisser sur la pointe des pieds et les places à 46 € en orchestre. Et sur scène, des acteurs comme à la télé jouant très pros des pièces à texte, textes qui respectent la règle d'or selon laquelle il faudra tôt ou tard absolument tout expliquer au spectateur. Si l'on préfère un spectacle qui laisse un peu à imaginer, mieux vaut aller voir ailleurs des personnages se taire et danser.
escaliers, les spectateurs bien habillés dont des dames à visons, les rideaux très rouges et les dorures au plafond, le sentiment de s'y glisser sur la pointe des pieds et les places à 46 € en orchestre. Et sur scène, des acteurs comme à la télé jouant très pros des pièces à texte, textes qui respectent la règle d'or selon laquelle il faudra tôt ou tard absolument tout expliquer au spectateur. Si l'on préfère un spectacle qui laisse un peu à imaginer, mieux vaut aller voir ailleurs des personnages se taire et danser.