Vient bientôt le temps des fêtes de fin d'année, le temps des réunions de famille. Les réunions des familles qui se réunissent encore, c'est à dire celles qui n'ont pas hérité. Pour se préparer à y survivre, il est bon d'aller voir "Juste la fin du monde" de Jean Luc Lagarce (1957-1995). Pour ne pas y retrouver Lagarce, qui depuis 12 ans est mort, mais pour découvrir ou retrouver son oeuvre, une oeuvre en bonne voie, semble-t-il, de lui survivre longtemps. Quitte à échapper à son auteur autant que nécessaire. Paul, le principal protagoniste, qui va bientôt mourir et veut revoir sa famille, n'est pas/n'est plus Jean Luc Lagarce, qui avait écrit la pièce se sachant condamné par le sida. Paul est Paul, simplement, avec les traits ronds et murs d'Hervé Pierre (sans la barbe de Coltrone), qui répète avec gourmandise et sans essayer de convaincre qu'il a trente-cinq ans. La mort est toujours présente, mais passe un peu au second plan.
Paul revient dans sa famille, pour parler, dire la vérité (sur son état, seulement, ou sur lui, plus généralement?), et ne le peut, évidemment. Pas plus que Paul n'a pu, marchant une nuit sur un pont entre ciel et terre, gueuler un cri pour de bon. C'est l'un des puissants paradoxes de ce théâtre de nous montrer des personnages parler pendant une heure et demi pour démontrer qu'ils sont dans l'impossibilité de communiquer. Avec une langue très pure, un peu blanche, comme en perpétuelle recherche d'elle même, même si quelques effets de répétition résonnent parfois comme des exercices de conjugaison. On le pardonne volontiers, car ces répétitions font sens, témoignant de la difficulté qu'ont les personnages à se définir par les mots. Ce texte est porté avec énergie et intelligence, avec conviction. Il est vrai que les acteurs- Danielle Lebrunen tête- ont de sérieux états de service. On entend ici des phrases superbement impossibles mais jouées de manière réaliste, à rebours d'un certain théâtre contemporain qui se saisit souvent de textes classiques pour leur faire subir un traitement distancié.
Car c'est peut être avant tout d'un théâtre de situation, un théâtre psychologique, dont il s'agit ici. Un théâtre moderne et adulte, pour tout dire. Le fils aîné revient, mais le retour est impossible pour qui un jour est parti. Ceux qui sont restés entre eux- la mère, le frère, la soeur- se sont renfermés ensemble sur les souvenirs des vieilles querelles, dans un inconfort qu'il est trop douloureux pour eux de remuer. La place de chacun est assignée, la scène est barrée de tout son long par le mur imposant d'une maison, par ses ouvertures apparait la vue d'un ciel tourmenté. Image d'une subjectivité vers laquelle chacun pourtant parvient à son tour à s'échapper, quand les névroses familiales éclatent brusquement en accès de violences, avant de s'éssouffler en renoncements, au goût doux amer du pardon.
"Qui peut dire comment les choses disparaissent?"
C'était Juste la fin du monde ♥♥♥♥♥ de Jean Luc Largarce, mis en scéne par François Berreur, avec Hervé-Pierre-de-la-comedie-française, Danièle Lebrun, Elizabeth Mazev, Clotilde Mollet, Bruno Wolkowitch, au Théatre de la Cité Internationale en partenariat avec le Théatre de la Ville. Jusqu'au 25 novembre
P.S. du 25/11: quelques images ici et quelques échanges, sur un air de théatre
 pendant quelques siècles. En tous cas une pièce atypique dans la production shakespearienne: ici nulle passion qui menerait un Macbeth ou un Othello jusqu'à son propre anéantissement, ni intrigue à proprement parler qui nous tiendrait en haleine. Trahisons, luttes de pouvoir: toute l'action a eu lieu avant la pièce, dans un temps ordinaire, suspendu par la tempête. Ensuite, comme dans les séries d'aujourd'hui, les naufragés rencontreront leur vérité à travers les épreuves. Mais c'est l'île elle même- et ses incarnations primitives: Ariel et Caliban- qui est le personnage principal de la pièce. Un lieu de magie, mais comme empreint d'une lassitude apaisée, où les passions se résolvent, où les fautes sont pardonnées.
pendant quelques siècles. En tous cas une pièce atypique dans la production shakespearienne: ici nulle passion qui menerait un Macbeth ou un Othello jusqu'à son propre anéantissement, ni intrigue à proprement parler qui nous tiendrait en haleine. Trahisons, luttes de pouvoir: toute l'action a eu lieu avant la pièce, dans un temps ordinaire, suspendu par la tempête. Ensuite, comme dans les séries d'aujourd'hui, les naufragés rencontreront leur vérité à travers les épreuves. Mais c'est l'île elle même- et ses incarnations primitives: Ariel et Caliban- qui est le personnage principal de la pièce. Un lieu de magie, mais comme empreint d'une lassitude apaisée, où les passions se résolvent, où les fautes sont pardonnées.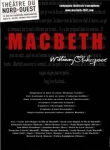 l'arbitre, c'est le grand Will en personne. Dans les ceux équipes, pas de stars internationale, mais des talents déjà remarqués. A noter, au nombre des transferts, Audrey Sourdive, déjà remarquée en pilier dans la mêlée des religieuses de
l'arbitre, c'est le grand Will en personne. Dans les ceux équipes, pas de stars internationale, mais des talents déjà remarqués. A noter, au nombre des transferts, Audrey Sourdive, déjà remarquée en pilier dans la mêlée des religieuses de  bien occupé, dominé d'un bout à l'autre. L'avantage est assuré par un jeu de haut niveau dés le début de partie, sur les thèmes de la prodigalité de Timon et de l'hypocrisie de ses invités. Jerome Keen marque l'essai. Actions d'équipes brillantes à la mi temps, alors que Timon est ruiné, la scène du banquet d'eau chaude servi aux convives avides est d'une précision et d'une énergie à couper le souffle. Dans un même mouvement, l'aisance et l'efficacité. La transformation est réussie, lors d'une belle malédiction jetée à la face d'Athènes, par un Timon amer. Le choc: on est plaqué. Fin de partie un peu moins vive, plus défensive, avec Timon l'ermite.
bien occupé, dominé d'un bout à l'autre. L'avantage est assuré par un jeu de haut niveau dés le début de partie, sur les thèmes de la prodigalité de Timon et de l'hypocrisie de ses invités. Jerome Keen marque l'essai. Actions d'équipes brillantes à la mi temps, alors que Timon est ruiné, la scène du banquet d'eau chaude servi aux convives avides est d'une précision et d'une énergie à couper le souffle. Dans un même mouvement, l'aisance et l'efficacité. La transformation est réussie, lors d'une belle malédiction jetée à la face d'Athènes, par un Timon amer. Le choc: on est plaqué. Fin de partie un peu moins vive, plus défensive, avec Timon l'ermite. Mais du tout furieux de ce soir, la part plus audacieuse, et la meilleure, tient plus aux mots- les mots écrits par
Mais du tout furieux de ce soir, la part plus audacieuse, et la meilleure, tient plus aux mots- les mots écrits par  C'est sans doute la question la plus importante posée par la pièce. La seule question, même. A chaque mise en scène sa propre réponse. Ce soir la réponse est claire: on ne voit que Iago, qui tire toutes les ficelles, et Othello mené par le bout du nez. Ce qui reporte l'attention sur les motivations de Iago. Envieux ordinaire, ou être démoniaque? On se focalise sur ce personnage, mais peut être par l'effet d'un déséquilibre palpable du jeu: Iago (Alexandre Mousset, qui était tout autant remarquable dans le costume du fou de
C'est sans doute la question la plus importante posée par la pièce. La seule question, même. A chaque mise en scène sa propre réponse. Ce soir la réponse est claire: on ne voit que Iago, qui tire toutes les ficelles, et Othello mené par le bout du nez. Ce qui reporte l'attention sur les motivations de Iago. Envieux ordinaire, ou être démoniaque? On se focalise sur ce personnage, mais peut être par l'effet d'un déséquilibre palpable du jeu: Iago (Alexandre Mousset, qui était tout autant remarquable dans le costume du fou de  spontanées, et si systématiquement que cela à la longue peut agacer. Mais, si l'on est mieux disposé, la naïveté peut passer pour de la poésie. Et c'est, tous comptes faits, un mode d'expression approprié pour ces personnages tous un peu désoeuvrés, en quête de rêves et d'ailleurs, qui ont perdus le sens. Déboussolés par les "trous dans le ciel", la chaleur des nuits de polars et l'effacement des saisons. Des "essayeurs de vie". Qui forment une drôle de famille: un père travesti et en crise de larmes permanente, des frères détrousseurs de cadavres (pour marquer la dramatisation, faut il ouvrir sur du sordide?), leurs improbables amoureuses, et un poète alsacien en route vers la Californie. Une famille dont les liens échouent à consoler le mal-être de chacun.
spontanées, et si systématiquement que cela à la longue peut agacer. Mais, si l'on est mieux disposé, la naïveté peut passer pour de la poésie. Et c'est, tous comptes faits, un mode d'expression approprié pour ces personnages tous un peu désoeuvrés, en quête de rêves et d'ailleurs, qui ont perdus le sens. Déboussolés par les "trous dans le ciel", la chaleur des nuits de polars et l'effacement des saisons. Des "essayeurs de vie". Qui forment une drôle de famille: un père travesti et en crise de larmes permanente, des frères détrousseurs de cadavres (pour marquer la dramatisation, faut il ouvrir sur du sordide?), leurs improbables amoureuses, et un poète alsacien en route vers la Californie. Une famille dont les liens échouent à consoler le mal-être de chacun. chemin dans l'ombre de Tarquin vers son crime, déjà sur la couche de Lucrèce l'opposition violente du rouge et du bleu. Puis la brutalité précipitée des gestes. Après, de quelques mouvements, le dégoût muet et prévisible qui envahi Tarquin. Le désespoir, la mort de Lucrèce.
chemin dans l'ombre de Tarquin vers son crime, déjà sur la couche de Lucrèce l'opposition violente du rouge et du bleu. Puis la brutalité précipitée des gestes. Après, de quelques mouvements, le dégoût muet et prévisible qui envahi Tarquin. Le désespoir, la mort de Lucrèce.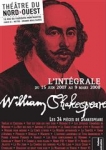 de Shakespeare est universelle. Si cette oeuvre est universelle, elle appartient donc à tout le monde. Si elle appartient à tout le monde, chacun peut bien en faire ce qu'il veut. Et détourner les flots du texte vers les préoccupations de l'époque. Chaque génération voit Willy à sa porte.
de Shakespeare est universelle. Si cette oeuvre est universelle, elle appartient donc à tout le monde. Si elle appartient à tout le monde, chacun peut bien en faire ce qu'il veut. Et détourner les flots du texte vers les préoccupations de l'époque. Chaque génération voit Willy à sa porte.