Le lieu est très déglingué- en comparaison Mains d'Oeuvresressemblerait au Palais de Chaillot-: affiches collées aux murs en guise de rideaux, pas une chaise qui ressemble à celle d'à coté, verre de rouge ou thé tiède, toilettes à la turque et bric à brac dans l'arrière cour. On s'y sent donc bien, on a réservé mais quelqu'un (qui?) nous a invité, c'est un peu à Montreuil le premier festival parisien de l'été.
Ce soir Corps etc... commence avec Sand, dansé par Romuald Luydlin. La Rock&Roll attitude se porte bien et tendance sur les scènes cette année: on a vu Kataline Patkai en Jim Morrison, et Mette Ingvartsen-se glissant nue dans le genre, efficace dans l'allusion. Et on a pas vu le championnat d'air guitar à la Fondation Cartier. Mais justement, que reste-t-il du rock quand la guitare est imaginaire, ou ici le danseur en chanteur sur bande orchestre? Juste l'attitude, et encore: ce soir le Rock&Roll Hero est fatigué, et les dix minutes de performance très léthargiques. Le bouton de l'ampli imaginaire bloqué à fond sur la réverbération, pour une ambiance David Lynch à petit budget. Paresse ou fausse route? La danse se heurte aux limites de l'imitation, comme le danseur bridé par le fil du vrai micro. Dommage, on se souvenait de La Zampa en plus énervé.
Aprés: Christie Lehuédé pour un extrait d'Autopsie d'une émotion 1, déja vu cette année à Artdanthé. Toujours d'une intelligente, belle, énergique sécheresse. On lit le dossier de presse, et on doit concéder qu'il y a parfois tout de même un rapport entre ce que les artistes écrivent, ou font écrire, sur eux-mêmes, et ce qu'ils donnent à voir sur scène. Ce que dit la danseuse quant à l'inspiration qu'elle a trouvé dans les travaux du docteur Charcot, sur la recherche d'un geste impulsif pour couper court à tout sentimentalisme dans l'exposé, fait sens. Qu'ajouter? De quoi décourager un peu nos commentaires antérieurs. Faut il continuer à écrire quand même? Extrapoler dans l'imaginaire? C'est le dilemme des chaussettes à têtes de mort portées par Eléonore Didier.
Mais pour couper court à ces reflexions, avant la pause une lecture d'Antonin Artaud. On frôle la consternation, l'incrédulité. Mais Raphaèlle Gitlis sauve brillamment la situation. Bonne introduction aux affres de Monoi par Nadège Prugnard. Dont on parlera tôt ou tard.
C'était Sand de la Zampa et Autopsie... de Christie Lehuédé. Dans le cadre du festival Corps,etc.. à la Guillotine. Jusqu'à samedi 29 septembre.
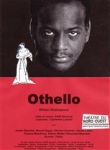 C'est sans doute la question la plus importante posée par la pièce. La seule question, même. A chaque mise en scène sa propre réponse. Ce soir la réponse est claire: on ne voit que Iago, qui tire toutes les ficelles, et Othello mené par le bout du nez. Ce qui reporte l'attention sur les motivations de Iago. Envieux ordinaire, ou être démoniaque? On se focalise sur ce personnage, mais peut être par l'effet d'un déséquilibre palpable du jeu: Iago (Alexandre Mousset, qui était tout autant remarquable dans le costume du fou de
C'est sans doute la question la plus importante posée par la pièce. La seule question, même. A chaque mise en scène sa propre réponse. Ce soir la réponse est claire: on ne voit que Iago, qui tire toutes les ficelles, et Othello mené par le bout du nez. Ce qui reporte l'attention sur les motivations de Iago. Envieux ordinaire, ou être démoniaque? On se focalise sur ce personnage, mais peut être par l'effet d'un déséquilibre palpable du jeu: Iago (Alexandre Mousset, qui était tout autant remarquable dans le costume du fou de 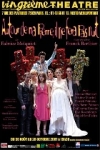 spontanées, et si systématiquement que cela à la longue peut agacer. Mais, si l'on est mieux disposé, la naïveté peut passer pour de la poésie. Et c'est, tous comptes faits, un mode d'expression approprié pour ces personnages tous un peu désoeuvrés, en quête de rêves et d'ailleurs, qui ont perdus le sens. Déboussolés par les "trous dans le ciel", la chaleur des nuits de polars et l'effacement des saisons. Des "essayeurs de vie". Qui forment une drôle de famille: un père travesti et en crise de larmes permanente, des frères détrousseurs de cadavres (pour marquer la dramatisation, faut il ouvrir sur du sordide?), leurs improbables amoureuses, et un poète alsacien en route vers la Californie. Une famille dont les liens échouent à consoler le mal-être de chacun.
spontanées, et si systématiquement que cela à la longue peut agacer. Mais, si l'on est mieux disposé, la naïveté peut passer pour de la poésie. Et c'est, tous comptes faits, un mode d'expression approprié pour ces personnages tous un peu désoeuvrés, en quête de rêves et d'ailleurs, qui ont perdus le sens. Déboussolés par les "trous dans le ciel", la chaleur des nuits de polars et l'effacement des saisons. Des "essayeurs de vie". Qui forment une drôle de famille: un père travesti et en crise de larmes permanente, des frères détrousseurs de cadavres (pour marquer la dramatisation, faut il ouvrir sur du sordide?), leurs improbables amoureuses, et un poète alsacien en route vers la Californie. Une famille dont les liens échouent à consoler le mal-être de chacun.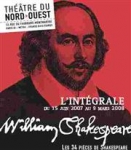 chemin dans l'ombre de Tarquin vers son crime, déjà sur la couche de Lucrèce l'opposition violente du rouge et du bleu. Puis la brutalité précipitée des gestes. Après, de quelques mouvements, le dégoût muet et prévisible qui envahi Tarquin. Le désespoir, la mort de Lucrèce.
chemin dans l'ombre de Tarquin vers son crime, déjà sur la couche de Lucrèce l'opposition violente du rouge et du bleu. Puis la brutalité précipitée des gestes. Après, de quelques mouvements, le dégoût muet et prévisible qui envahi Tarquin. Le désespoir, la mort de Lucrèce.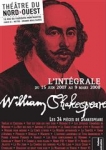 de Shakespeare est universelle. Si cette oeuvre est universelle, elle appartient donc à tout le monde. Si elle appartient à tout le monde, chacun peut bien en faire ce qu'il veut. Et détourner les flots du texte vers les préoccupations de l'époque. Chaque génération voit Willy à sa porte.
de Shakespeare est universelle. Si cette oeuvre est universelle, elle appartient donc à tout le monde. Si elle appartient à tout le monde, chacun peut bien en faire ce qu'il veut. Et détourner les flots du texte vers les préoccupations de l'époque. Chaque génération voit Willy à sa porte. dégorgée de la pensée humaine, jusqu'au bout de l'idiotie, des mots-bulles tentent de se former avant d'éclater aux lèvres. Sur le corps humide et blanc et sur le mur du fond sont projetées des diapos éducatives d'histoires naturelles. Histoire de rassurer? L'innocence d'avant le langage semble presque à portée de langue, d'avant la sexualité même, un hermaphrodisme placide s'affiche sous la forme d'un postiche naïf fixé sur les reins nus. La régression s'offre trés généreuse, effrayante et délicieuse, vers une grâce pataude en une reptation de bruits mous, slurp. La jubilation de la salissure s'exprime sans retenue, enfantine, sous une cascade de sauce tomate, le corps s'abandonne sans réserves à l'immersion intégrale dans le sel alimentaire, nourri d'oubli. Cette poésie naturelle est gluante et basique, aussi belle que posée sur une feuille de laitue.
dégorgée de la pensée humaine, jusqu'au bout de l'idiotie, des mots-bulles tentent de se former avant d'éclater aux lèvres. Sur le corps humide et blanc et sur le mur du fond sont projetées des diapos éducatives d'histoires naturelles. Histoire de rassurer? L'innocence d'avant le langage semble presque à portée de langue, d'avant la sexualité même, un hermaphrodisme placide s'affiche sous la forme d'un postiche naïf fixé sur les reins nus. La régression s'offre trés généreuse, effrayante et délicieuse, vers une grâce pataude en une reptation de bruits mous, slurp. La jubilation de la salissure s'exprime sans retenue, enfantine, sous une cascade de sauce tomate, le corps s'abandonne sans réserves à l'immersion intégrale dans le sel alimentaire, nourri d'oubli. Cette poésie naturelle est gluante et basique, aussi belle que posée sur une feuille de laitue. Belle troupe qui chante à l'unisson, dont trois rousses qu'un ado dévore des yeux. Belle invitation, évocation un peu canaille, mais assez sage à tout prendre, des bas-fonds de Vienne.
Belle troupe qui chante à l'unisson, dont trois rousses qu'un ado dévore des yeux. Belle invitation, évocation un peu canaille, mais assez sage à tout prendre, des bas-fonds de Vienne. par la porte de la salle du haut surgissent des comédiens qu'on ne peut pas ne pas remarquer- des ours, un curé, un juge, des dames en robes d'époque, des jeunes premiers, un Falstaff qui se saisit de bois de cerfs...- ils tournent en rond seuls ou à plusieurs, mais toujours un peu absents, et bientôt repartent dedans à l'assaut. Et chaque fois que la porte de la salle du haut s'ouvre, on entend d'où l'on est quelques répliques et des éclats de voix, des applaudissements.
par la porte de la salle du haut surgissent des comédiens qu'on ne peut pas ne pas remarquer- des ours, un curé, un juge, des dames en robes d'époque, des jeunes premiers, un Falstaff qui se saisit de bois de cerfs...- ils tournent en rond seuls ou à plusieurs, mais toujours un peu absents, et bientôt repartent dedans à l'assaut. Et chaque fois que la porte de la salle du haut s'ouvre, on entend d'où l'on est quelques répliques et des éclats de voix, des applaudissements. Rigoulot se découvrent l'un l'autre en un duo sensuel et amoureux, Malena Murua fait une avec un rideau de tente et on ne lasse pas de suivre la fébrile
Rigoulot se découvrent l'un l'autre en un duo sensuel et amoureux, Malena Murua fait une avec un rideau de tente et on ne lasse pas de suivre la fébrile  programme. Pourtant ici pas de rocher à pousser, mais sur scène un tas de gravats. Perchée au dessus, la condition humaine, à l'épreuve de sa vérité. Un danseur en costume de ville- Haïm Adri- au corps et la mémoire habités par le foisonnement des danses populaires, le coeur assailli par la surabondance des musiques et des images sonores. Les mains dans la poussière, se saisissant de la matière, cailloux après cailloux, le regard perdu et un peu fou. Pour une heure de course offerte, c'est grave et émouvant.
programme. Pourtant ici pas de rocher à pousser, mais sur scène un tas de gravats. Perchée au dessus, la condition humaine, à l'épreuve de sa vérité. Un danseur en costume de ville- Haïm Adri- au corps et la mémoire habités par le foisonnement des danses populaires, le coeur assailli par la surabondance des musiques et des images sonores. Les mains dans la poussière, se saisissant de la matière, cailloux après cailloux, le regard perdu et un peu fou. Pour une heure de course offerte, c'est grave et émouvant. pays de l'illusion, et de toutes les possibilités. On perd pied dans les sables mouvants de l'imaginaire amoureux, où chacun ose se rêver, sans interdit de rang ou de sexe, dans les bras de l'être aimé. Lui même reconstruit selon tous nos désirs.
pays de l'illusion, et de toutes les possibilités. On perd pied dans les sables mouvants de l'imaginaire amoureux, où chacun ose se rêver, sans interdit de rang ou de sexe, dans les bras de l'être aimé. Lui même reconstruit selon tous nos désirs. 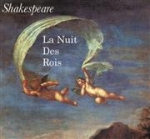 flagrant, à l'inverse d'un certain Fabien aimant Sebastien-le frère jumeau- jusqu'à se faire battre pour le défendre.
flagrant, à l'inverse d'un certain Fabien aimant Sebastien-le frère jumeau- jusqu'à se faire battre pour le défendre.